François-René Simon: le surréalisme à la première personne
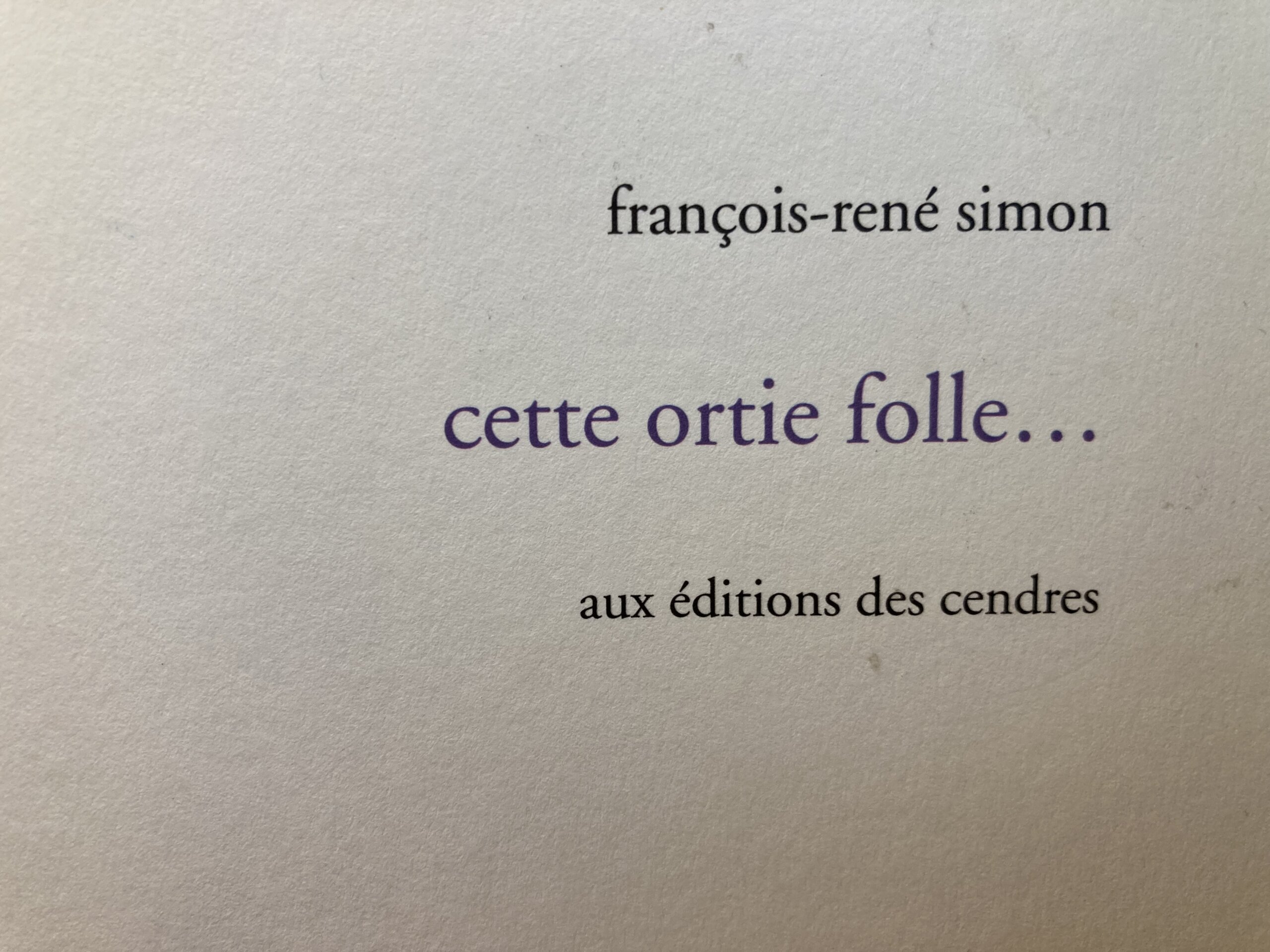
Ainsi pourrait-on qualifier son livre “cette ortie folle…” [sic] publié l’an dernier aux éditions des cendres [re-sic]. Ce collaborateur de Jazz Magazine, n’y parle ni de Coltrane, ni même de foot, mais de son histoire avec le surréalisme qui l’attira, jeune adulte, à Paris où il fréquenta André Breton et les activistes de ce mouvement artistique.
François-René Simon. Quatre syllabes familières aux lecteurs de Jazz Magazine. Dans les rédactions comme dans tout milieu professionnel et/ou spécialisé, on tend vers le diminutif ou tout du moins à la contraction, à la concision. À Philippe, on préférait souvent “Carles”, mais Goaty est devenu “Fred” qui a fait de Bergerot “Tonton” et, concernant ses idoles, le jazzfan va au plus court et/ou au mieux sonnant : “Miles”, “Trane”, “Wes”, “Herbie”, “Monk”, “Mingus”, “Bird”, “Getz”, etc. Concernant François-René Simon, il eût été malvenu de faire de son patronyme un prénom. Mais il me tança vertement le jour où j’osais l’interpeler d’un bref “François”, une liberté qu’il interdit, le seul diminutif qu’il accepte étant FRS (prononcez frs… comme vous pouvez. Le résultat mérite le détour). Auparavant, il avait fait preuve d’une colère froide lorsque, tout juste passé de Jazzman à Jazz Magazine, je m’autorisai à lui supprimer quelques lignes en tête d’une chronique de disque, où il dénonçait l’appel à la délation contre les dépôts d’ordure sauvage dans la commune d’Eymet. Et j’imagine qu’il prendrait un malin plaisir à biffer d’un crayon rageur ces quelques digressions en introduction à la chronique de son livre sur le surréalisme.
Passé cet accroc dont l’origine n’était peut-être qu’une forme de bizutage de sa part en guise d’accueil au nouveau rédac-chef, notre collaboration m’a confirmé ce que j’avais deviné de lui auparavant : un bon camarade, une malice et un humour pince sans rire qui ne s’interdisait pas un franc esclaffement. Nous nous savions l’un et l’autre saxophoniste à peine plus médiocre l’un que l’autre, mais pour ne l’avoir entendu qu’une fois à la sauvette, je le savais plus affranchi que moi dans sa pratique de l’improvisation, la mienne se limitant en quelque sorte à de l’arpège d’accords enseigné par le bon professeur Fohrenbach. Je soupçonne FRS d’être avec moi le seul de la rédaction en possession des 800 pages et des 1,75 kilos de The John Coltrane, The Référence (ouvrage collectif dirigé par Lewis Porter), et il reste le Monsieur John Coltrane de Jazz Magazine pour ne s’être jamais remis de l’avoir vu et entendu à Antibes en 1965. Enfin, j’appréciais l’aisance, l’élégance de sa plume directe et sans coquetterie, parfois la rouerie pleine d’esprit avec laquelle il pouvait contourner une difficulté… et pour cela, à lire ses papiers toujours avec plaisir, j’ai appris à le jalouser un peu.
Pour le reste, je le savais amateur de foot, journaliste professionnel ayant touché à différents domaines, familier de la société Filipacchi… et on le disait versé dans le monde du surréalisme. So what !?
Or, récemment, au cours d’un échange de courriels, il m’en a dit un peu plus sur ce dernier sujet, à peine plus… suffisamment en tout cas pour que je m’empresse de commander son livre paru aux “éditions des cendres” sous le titre “cette ortie folle…” Notez ici l’absence de majuscules, car il se pourrait bien qu’à ne pas respecter la typographie de ce titre et de ce nom d’éditeur je me heurte à cette même colère qui inaugura notre collaboration à Jazz Magazine.
À vrai dire, je ne savais guère à quoi m’attendre en ouvrant les pages dont je vais parler, le mot surréalisme m’ayant toujours évoqué quelque secte secrète et très fermée jonglant avec la difficulté à ne pas faire de l’anti-dogmatisme un nouveau dogme. Sur la page de titre la mention d’éditeur AUX ÉDITIONS DES CENDRES est imprimée en capitales … mais donc, toujours sans majuscule, le titre également en capitales se voyant attribuer une majuscule à l’initiale du premier mot (distraction de maquettiste ?). Les deux lignes suivantes me plongèrent dans une grande perplexité :
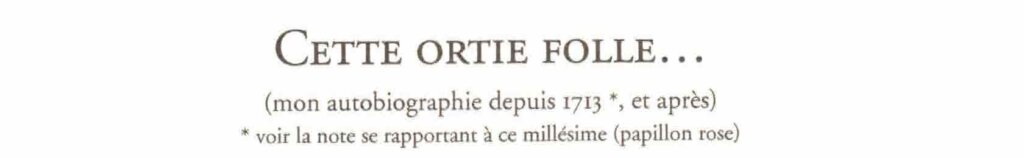
Parvenu à la dernière page du livre, je viens de relire ce “papillon rose”… qui laisse deviner une sorte de jeu de piste… “papillon rose” (Note sur le millésime 1713) dont je n’ai toujours rien compris ou n’en ai pas eu la patience. À l’inverse, la lectures les premières pages – juste pour voir –, m’aura lancé sur la piste du jeu (du Je, c’est-à-dire Lui) avec une telle impatience que j’ai laissé en plan toutes mes autres lectures en cours. Et je me suis laissé happer par cette écriture malicieuse dont j’avais pressenti les charmes à la lecture de ses chroniques, quoiqu’il s’interdise ici toute référence au jazz hors de rares repères biographiques, puisqu’il s’agit d’autobiographie, donc principalement le concert de Coltrane à Antibes dont il ne dit d’ailleurs rien sinon qu’il y était.
Le reste est cet océan artistique qu’est le monde du surréalisme sur lequel il restait discret dans les locaux de Jazz Magazine. Ou plus exactement la passion qu’il en a conçu en toute candeur, jeune lycéen grandi à Chaumont, gros nœud ferroviaire au milieu d’une Haute-Marne située sur cette “Diagonale du vide” caractérisant la France dépeuplée; passion qui le décida un beau jour, à la lecture de Nadja, de “monter” à la Capitale pour rencontrer André Breton.
On peut y lire une initiation – celle de FRS que l’on voit, lycéen, naître à la lecture, à l’écriture, à un courant et à son histoire, celle qu’il vécut de l’intérieur à compter de 1965 (date sa première visite, âgé de 20 ans, à André Breton suite à un échange de lettres) à 1969 (la dissolution du mouvement), en passant par sa fréquentation assidue du cénacle et de ses réunions à La Promenade de Vénus. On s’y instruit, on y découvre des personnages, des œuvres, des débats esthétiques, des dissidences et des convergences, des jalousies et des trahisons, des histoires d’excommunication et de scission, la gestion, la récupération, la perpétuation d’un héritage, un sillage et ce problème qui fut peut-être fatal au courant : que faire de Mai 68. Le dogmatisme y voisine avec une libre pensée, un déverrouillage du mot, du verbe, du sens, de l’image, une imagination débridée, des feux d’artifice de bons mots, de calembredaines, de farces et attrapes, de grands œuvres et de coups de génie.
Ça pourrait être ennuyant – et ça l’est ici ou là pour le non initié à cet univers lorsqu’un chapitre verse dans le name dropping, parfois de prénoms sans leurs patronymes se succédant sans que l’on ne sache plus à qui on a affaire, sauf à progresser dans sa lecture muni d’un crayon et de petites fiches. Mais, quitte à sauter quelques lignes ou quelques pages, on peut se laisser guider en suivant ce regard passionné, fasciné, engagé, partisan, parfois dubitatif voire narquois de François-René qui nous tient en haleine ; l’aventure de ce provincial qui découvre Paris, le monde de l’art, des livres, de la pensée à travers ce courant de pensée et de création ; et c’est surtout cette fantaisie “surréaliste” qu’il fait sienne par son écriture, par son humour, sa rébellion intime, sa modestie, les initiatives qu’il rapporte et, confident pudique, la vie privée, amoureuse notamment, qui s’y rapporte ; la distance qu’adopte son regard sur ce qui est tout à la fois les petites histoires individuelles et l’Histoire d’un collectif (tiens, voici Daniel Filipacchi… il ne fait que passer non sans prêter à FRS un gouache historique de Jacques Hérold le temps d’une expo) et sa propre histoire, avec ce sentiment d’appartenance à un monde qui le dépasse, où pourtant il a été admis par le chef de file et fondateur en personne.
Aiguisé par la nouveauté et son aptitude au surréalisme, son regard de provincial est un régal, qu’il découvre Paris à travers l’œuf mayonnaise au comptoir et le « sec-beurre, une demie-baguette croustillante onctueusement beurrée et garnie, comme un jupon qui dépasse, de fines lamelles de rosette de Lyon semée de poivre noir », où qu’il considère « ses immeubles si hauts qu’on les croirait pendus au ciel, ses autobus à plateforme que l’on peut attraper à la course, ses feux rouges qui immobilisent les voitures comme des antilopes avant la traversée du gué, ses intellectuels à imperméable cassé, sa double trépidation diurne et nocturne, ses cinémas permanents sans publicité, ses cafés bordés de trottoirs comme l’écrivait l’encore surréaliste Aragon… » ; qu’il narre encore l’intimité des réunions, leurs rites, leurs disputes entre adoubements et disgrâces ou les séjours au sein du cénacle réuni l’été autour de la résidence d’été de Breton pour chasser le papillon ou la pierre de sagesse dans le cours du Lot ; qu’il brosse encore les portraits des disciples, des dissidents, de ceux qui furent ses amis, vrais et faux, ses fâcheux, ses traîtres… ou les amourées de sa vie de jeune adulte.
Mais peut-être m’aurait-il fallu commencer par cet avertissement que François-René Simon nous adresse en préambule: « Attention, ceci n’est pas un énième livre sur André Breton. C’est un premier livre sur moi. » Nous en promettrait-il un prochain qui ne serait pas un énième livre sur le jazz…? Je n’ai pas osé lui poser la question. Franck Bergerot