Sous l’emprise du jazz par Jean Améry
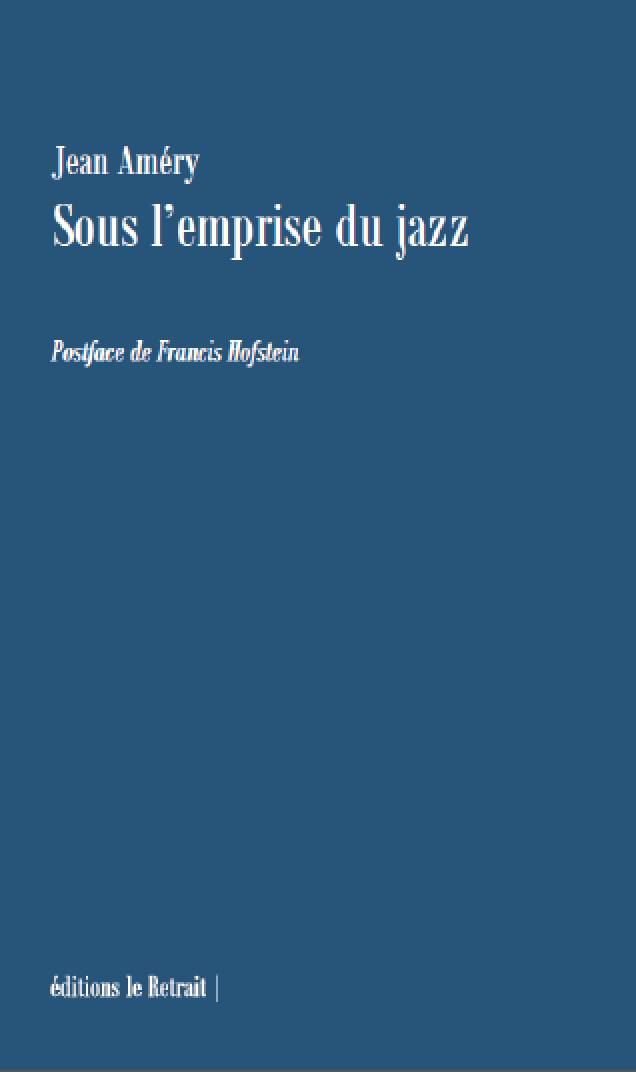
Francis Hofstein édite aux éditions Le Retrait, un recueil de portraits de jazzmen de 1961 de l’écrivain Jean Améry, juif autrichien rescapé des camps de concentration. Une publication moins anodine qu’il n’y paraît.
Je me suis procuré – non sans quelque difficulté si j’en crois mon libraire, Sous l’emprise du jazz de Jean Améry – plus par une curiosité qu’éveilla un mail de Francis Hofstein m’avertissant de cette parution semble-t-il très confidentielle, qu’avec l’intention de m’en faire l’écho en des pages “livres” d’autant plus sélectives que l’édition française s’est quelque peu débridée ces dernier temps, pour ne rien dire de l’édition anglophone quasiment passée sous silence en France alors qu’infiniment plus riche. Mais l’existence de ce juif autrichien né Hans Maeier en 1912 à Vienne, qui mit fin à ses jours à 66 ans, après une vie traversée par la littérature et l’écriture (Les Naufragés, premier roman en 1935, mais publié en 2007), une pratique du piano bar à Berlin à la fin des années 1920, l’Anschluss et la fuite jusqu’en Belgique où il connut arrestations, évasions et torture comme résistant, la déportation comme juif (Auschwitz, marches de la mort, Bergen-Belsen) et, après libération, l’adoption de l’anagramme de Maeier en Améry (Hans = Jean en allemand) dont il signe essais (Par-delà le crime et le châtiment, essai pour surmonter l’insurmontable), romans et articles de presse, notamment des portraits de contemporains illustres pour un éditeur zurichois dont ces portraits de jazzmen réunis en 1961 sous le titre Im Banne des Jazz, et désormais disponible en traduction française.
À feuilleter distraitement ces portraits, on peut s’étonner d’abord de leur publication aujourd’hui, aussi soignée soit-elle. De ces petits portraits de musiciens n’en dispose-t-on pas à foison, plus ou moins précis, plus ou moins datés, rendus caducs par les ouvrages et les documents diffusés par l’édition anglophone et la circulation des archives qu’a facilitée le développement du fax puis d’internet depuis la fin du siècle dernier. Que nous faut-il un nouveau portrait de Louis Armstrong rédigé en un temps où on le faisait naître un an trop tôt (1900 au lieu de 1901) et d’autres concernant des artistes aussi largement et “exactement” documentés que Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Duke Ellington, Lester Young…
Si la liste des vingt artistes sélectionnés comporte des lacunes propres à l’origine de ces textes (on notera l’absence de Jelly Roll Morton, des as du stride, de Bud et Monk, Coleman Hawkins, tandis que Gene Krupa est le seul batteur ici documenté…), la présence de Lennie Tristano constitue une surprise qui retient notre attention avec une article où l’approximation et la contrevérité (Tristano débarquant de la Côte Ouest à New York ; lecteur par opposition au musiciens noirs non lecteurs… Comme Coleman Hawkins ? Comme Dizzy ? Comme Teddy Wilson ?) voisine avec une certaine clairvoyance pour ce musicien largement sous-estimé, surtout en ce début des années 1960.
Mais le véritable tort de cette publication, c’est d’abord que sa postface, signée Francis Hofstein, n’ait pas figuré plutôt en préface et que les portraits d’Améry n’ait pas été précédé de cette présentation de son œuvre et du contexte dans lequel ils ont été rédigés. Certes, Jean Améry avait prévu lui-même un avant-propos ici restitué où il relativisait lui-même l’importance de sa contribution, dont Hoffstein nous rappellera qu’elle résultait d’une nécessité, celle de gagner sa vie au service de la presse suisse alémanique durant les 15 années d’après-guerre qui précédèrent ses grands écrits : « Encore un livre sur le jazz ? écrivait-il lui-même. Bien sûr que non ! il existe aujourd’hui une multitude d’ouvrages […] Ce que nous apprenons ici se veut plutôt une petite sélection de récits sur les gens du jazz. »
Aussi ne lit-on pas ces portraits pour leur exactitude, mais pour le regard que porte Jean Améry, un regard d’humanité sur ”des gens” : Armstrong et sa pile de mouchoirs blancs, Charlie Parker et la mort de sa fille Pree, le « chagrin calme et fluide » de Duke Ellington, Lady Day et le Président, la force et la faim de Lionel Hampton, Bix Beiderbecke qu’il aurait bien vu incarné au cinéma par Gérard Philippe. Et peu importe si, dans ce rôle, on y verrait plutôt un Daniel Auteuil ou quelque autre acteur moins flamboyant, peu importe même qu’il y ait encore du Panassié dans le regard d’Améry sur la négritude, ces écrits sont ceux d’un homme pour qui le jazz fut nécessaire à sa survie pendant la déportation parce que, comme il le dit dans son avant-propos : « Les artistes du jazz sont les derniers rebelles, les derniers véritables bohémiens. Au siècle du triomphe de l’organisation, ils se font l’expression d’un individualisme radical et d’une liberté artistique absolue […] Même derrière les expressions les plus bourgeoises du monde du jazz, nous retrouvons la révolte de l’artiste contre la rationalité insipide qui l’entoure. »
Une publication soignée destinée à un public restreint, dont les spécialistes de la psychanalyse (spécialité à laquelle Hofstein lui-même praticien aime soumettre le jazz, et ici le destin de Jean Améry, dans un commentaire érudit, pertinent et souvent poignant), et à aussi à ceux pour qui le débat sur la relation de Theodor Adorno au jazz présente encore un quelconque intérêt. Franck Bergerot