Il ne s’agit pas ici de la vraie Chapelle des Lombards, authentique chapelle souterraine du 13e siècle, sise au 62 rue des Lombards. Ouverte en 1978, alors seul concurrent du Petit Opportun ouvert l’année précédente au 15 de la rue Sainte-Opportune, à 220 mètres l’un de l’autre, mais selon des programmations très distinctes, même si l’on y entendit Chet Baker ici et là. Comptant parmi ses fondateurs Rémy Kolpa-Kopoul et Pierre Goldman, je dirais, pour faire simple, que La Chapelle des Lombards était plus “gauchiste”, avec une programmation très ouverte, de la salsa à l’avant-garde des musiques improvisées. Mais surtout Les Lombards avaient l’allure d’une cathédrale comparée au Petit-Op où le public entrait au chausse-pied.
De la rue des Lombards à la rue de Lappe
Mes premières visites comme journaliste au titre d’Antirouille, journal de la jeunesse gauchiste et indépendante, m’avait valu d’y avoir facilement mes entrées. Je me souviens de la moustache du gérant Jean-Luc Fraisse derrière ce guichet au travers duquel un autre personnage qui m’avait à la bonne mais dont j’ai oublié le nom m’avait glissé au printemps 1979, alors qu’Antirouille venait de baisser le rideau : « Alors, il paraît que tu es passé à Jazz Hot ? ». Et aussi de l’attachée de presse, Agnès Lupovici, future madame Chautemps.

Jean-Louis, justement, le voici! Mais ce 30 janvier 1981, nous sommes au 19 rue de Lappe où la Chapelle des Lombards vient à peine de déménager dans un espace infiniment plus modeste, mais plus stratégique, dans la rue du bal musette, pour une programmation qui rapidement se spécialisera dans la musique latino-américaine, s’adressant ainsi à un public de danseurs. Pour mémoire, le 19 est l’adresse de l’historique bal des familles Aux Barreaux verts portant également en façade l’inscription “Aux Rendez-vous des Gars du Centre”, où l’on dansa sous une autre appellation dès 1850 chez un marchand de vins du nom de Salsac (retirez le c final pour voir…) et peut-être même auparavant au son d’un cabrettaire nommé Cambon (merci à Lucien Lariche et son précieux Les Jetons de bal, 1830-1940, lieux de danse célèbres et petits bals de quartier). « Tu parles d’une chapelle, ils y chantaient de drôles de cantiques. » aurait pu gouailler Jo Privat qui était chez lui au fameux Balajo, cinq numéros impairs plus loin.

Le big band de Martial Solal
Mais, les danseures du bal musette, Martial Solal s’en fichait probablement, tout au plaisir de réunir un nouveau un big band, deux décennies après “Mister Solal”. Il avait pu le présenter dès l’automne 1980, le 11 novembre au théâtre de Tourcoing et le 20 novembre au TEP (Théâtre de l’Est parisien). Mais cette fois-ci, c’était un gig inespéré d’une semaine au même endroit, qui, du 24 au 30 janvier, était offert à cet orchestre, dans ce mélange d’inconfort, de décontraction et de convivialité qu’offre le contexte du jazz-club.

Parmi le pupitre de saxophones du big band de Martial Solal, presque trop large pour tenir dans le champ de mon 35 mm ici avec la profondeur de champ minimale d’un diaphragme de 35mm ouvert au maximum : on reconnaît toutefois Jacques Di Donato (bars), François Jeanneau (ts), Jean-Louis Chautemps et Jean-Pierre Debarbat (as). Sur d’autres vues apparaissent Marc Steckar (ou du moins son tuba, figure obligée de ces nouveaux big bands dont je vais parler plus bas, avant qu’il ne fasse des petits au sein de son Tubapack), Tony Russo et Roger Guérin (tp), Jean-Paul Celea (b). Martial Solal est hors champs, probablement devant l’orchestre si j’en juge les regards des uns et des autres.

Les autres ? Dans son compte rendu pour Jazz Magazine dans le numéro de mars, François Billard liste tous les musiciens qui défilèrent là du samedi au vendredi, permanents ou remplaçants : outre ceux déjà cités, on y découvre Patrick Artero, Éric Le Lann, Bernard Marchais, Vincent Monplé (tp, bugle), Ahmid Belocine, Jacques Bolognesi, Raymond Katarzinski, Jean-Marc Walch (tb), Daniel Landrea (tuba), Alain Hatot, Pierre Mimram, Philippe Maté (saxes), Martial Solal (p, direction évidemment), Christian Escoudé, Frédéric Sylvestre (elg), Pierre Blanchard (vln), Michel Ripoche (vln basse), Hervé Derrien (cello), Cesarius Alvim (b), André Ceccarelli (dm). Cette liste de convives qui allaient et venaient au gré des disponibilités étant assortie par Billard d’un strict plan de table : 3 trompettes, 2 trombones, 1 tuba, 4 saxes, 1 violon, 1 violoncelle ou violon basse, 1 guitare, 1 contrebasse, 1 batterie.
Jeune homme, qu’entendez-vous par big band ?!
C’est le premier big band de mes archives photo. On assistait alors à la renaissance du big band français. Quoique l’on puisse faire remonter cette renaissance un peu plus tôt. Certains pourraient contester que le genre ne s’était jamais éteint grâce (avec des ambitions et selon des esthétiques diverses) à Claude Bolling, au Swing Limited Corporation, à Ivan Jullien “and his all stars”, Roger Guérin qui animait avec Kenny Clarke le big band de Saint-Germain-en-Laye… et encore Jean-Claude Naude, Claude Cagnasso et le benjamin Jean-Loup Longnon. On y ajoutera quelques expériences “libertaires” avec de vrais big bands tels celui de Didier Levallet et le Machi Oul Big Band des frères Villaroel et toutes sortes de hordes musicales rompant avec le protocole du big band, telles que La Compagnie Lubat, La Marmite infernale, une grande formation signalée sous le nom de Raymond Boni et l’inclassable Urban Sax et ses dizaines de saxophonistes en combinaisons anti-bactériologiques…
Lors de ma première année de collaboration à la presse jazz, pour le double numéro décembre-janvier de la fin 1979 de Jazz Hot qui comportait un dictionnaire des big bands, Laurent Goddet m’avait commandé la notice André Hodeir et conseillé de l’appeler. J’étais un grand admirateur d’Hodeir et de son Anna Livia Plurabelle. C’est donc terrifié à l’idée de le déranger au téléphone et d’avoir à me présenter pour une notice qui devait pas dépasser les 800 signes. Il m’accueillit assez fraîchement, sur le ton un peu pincé que d’aucuns lui ont connu « Mais qui êtes vous jeune homme ? » Puis : « Mais savez-vous que je n’ écris pas de la musique de big band ? Et d’abord qu’entendez-vous par big band ? » La douche froide ! Glacée !

André Hodeir était un homme pince-sans-rire, rigoureux, très à cheval sur l’exactitude des mots et des définitions. Big band = trois sections trompettes, trombones, saxophones, un piano, éventuellement une guitare rythmique, une basse, un batterie. Une définition souvent enfreinte par quelque extension ou quelque réduction, présence de quelques intrus (de la harpe au basson), voire même une désorganisation des sections, tous les soufflants se présentant sur une seule et même ligne à l’avant de la scène ou en demi-cercle comme on le voyait pratiquer sur les scènes européennes depuis l’émergence du Globe Unity Orchestra et de leurs cousins pionniers des dites “musique européennes improvisées” anglaises, hollandaises ou allemandes. Or, même dans des secteurs plus conventionnellement jazz, s’il y avait bien à la fin des années 1970 un renouveau de l’écriture orchestrale, le “band” n’était pas toujours aussi “big” qu’il aurait fallu. Ainsi, par manque de cuivres disponibles parmi les jeunes générations, Laurent Cugny s’était contenté d’une ligne de saxophones et flûtes plus un trombone pour son premier Lumière de 1980.
Les antécédents aux États-Unis ne manquaient pas. Le père du big band, Fletcher Henderson, reconnu comme tel, débute en 1923 avec un seul cornet, un seul trombone et trois saxophonistes, Duke Ellington n’enregistre ses premiers chefs d’œuvre de 1927 qu’avec deux trompettes, un trombone et trois saxophones et il faudra attendre les années 1930 pour voir des pupitres complets, jusqu’aux pléthoriques effectifs de Stan Kenton des années 1950. Mais d’autres modèles, d’autres formats, d’autres alliages sonores se sont imposés aux compositeurs et arrangeurs, tel Claude Thornhill, ses cors, ses tubas et ses bois, le nonette de Miles Davis qui fait école, notamment sur la West Coast, la diversification et les mélanges de timbres avec le recours aux flûtes et aux anches doubles, au cor et au tuba chez Gil Evans, la suppression de la guitare rythmique acoustique ou son remplacement par la guitare électrique pour d’autres rôles que métronomiques et qui au cours des années 1960 va se doter d’effets empruntés au rock, le piano remplacé ou complété par des claviers électriques et/ou percutés au sein d’une rythmique qui – au fur à mesures que les sections de vents se disloquent – grossit encore avec l’ajout à la batterie, de percussions latines ou autres. Au même moment, Joe Zawinul et ses claviers confèrent à Weather Report (quintette avec percussions) l’épaisseur sonore d’un big band et révolutionnent l’écriture orchestrale et la forme musicale par le recours aux techniques de studio.
Jef, l’europaméricain
Pour autant, au sein de l’Europamerica du toujours inattendu Jef Gilson, que j’entendis au festival de Moers le 2 juin 1979, un seul instrument électrique, le violoncelliste Jean-Charles Capon, côtoyait un seul trompettiste (Roger Guérin, grand soliste et pupitre des plus aguerris dans les clubs et les studios des années 1950, retenu ici par Jef Gilson pour remplacer… Lawrence “Butch” Morris, proche de David Murray et figure de ce renouveau du free jazz qu’on baptisa “Loft Generation” et qui, avec ses “conductions”, anticipera l’apparition du sound painting de Walter Thompson), plus une ribambelle de saxophonistes des plus “free” (André Jaume, Jacques Di Donato, Philippe Maté) au plus trad (Marc Richard, qui venait de créer l’Anachronic Jazz Band pour rhabiller le répertoire du bop et même Giant Steps “à la Fletcher Henderson”) en passant par les plus polyvalents (François Jeanneau et Jean-Louis Chautemps aguerris tant dans les clubs et les expériences libertaires que dans les studios de variétés), plus une simple rythmique : François Couturier (piano), Pierre-Yves Sorin (contrebasse) et Jacques Thollot (batterie). Ont-ils joué à Moers ce morceau dont j’adorais entendre Gilson annoncer – dans un bafouillis où se mêlait fierté, vocation pédagogique, un enthousiasme et une urgence adolescente – le titre de ce morceau de sa plume : Je me souviens encore du grand orchestre de Dizzy Gillespie en 1948.
Avançons !
Onztet, Polygruel et Pandemonium
Le 22 novembre 1979, François Jeanneau présente son Pandemonium au TEP : Katia Labèque (piano et synthétiseur), Christian Escoudé (guitare électrique), Didier Lockwood (violon électrique), Jean-Charles Capon (violoncelle électrique) plus Henri Texier, Daniel Humair, les congas de Michel Delaporte et un quatuor à cordes. Pas vraiment un big band, mais la volonté d’une certaines densité orchestrale autrefois, dans le jazz, réservée au big band… et le Pandemonium ne tardera pas à enrichir ses effectifs.
Le 27 février 1980, je me rends au Soleil en tête à Champigny-sur-Marne pour entendre le 5ème concert qu’y donne le Polygruel du bassiste électrique Laurent Cokelaere entouré d’autres nouveaux venus : 2 trompettes (Alain Darblay et Peter Volpe), 1 trombone (Philippe Renault), 5 saxes (Serge Roux au baryton, qui double au lyricon, Jean-Pierre Chatty et André Villéger à l’alto, Bertrand Auger et Francis Bourrec, ce dernier salué pour ses solos breckerien par le chroniqueur, ainsi que Villéger dans un style attaché à une certaine tradition), 1 violon électrique (Pierre Blanchard), 2 guitaristes électriques (Khalil Chahine et Philippe Drouillard, rejoint en cours de concert par un troisième, Claude Barthélémy bien décidé à faire sauter les plombs), 1 clavier (Bertrand Richard), 1 deuxième basse (la contrebasse de Patrice Caratini), 1 batteur (François Laizeau) et 1 percussionniste (Sidney Thiam). On y joue du Charles Mingus et du Herbie Hancock et on enchaine Charlie Parker à un riff de Jimi Hendrix (Machine Gun ! Ça barde !).
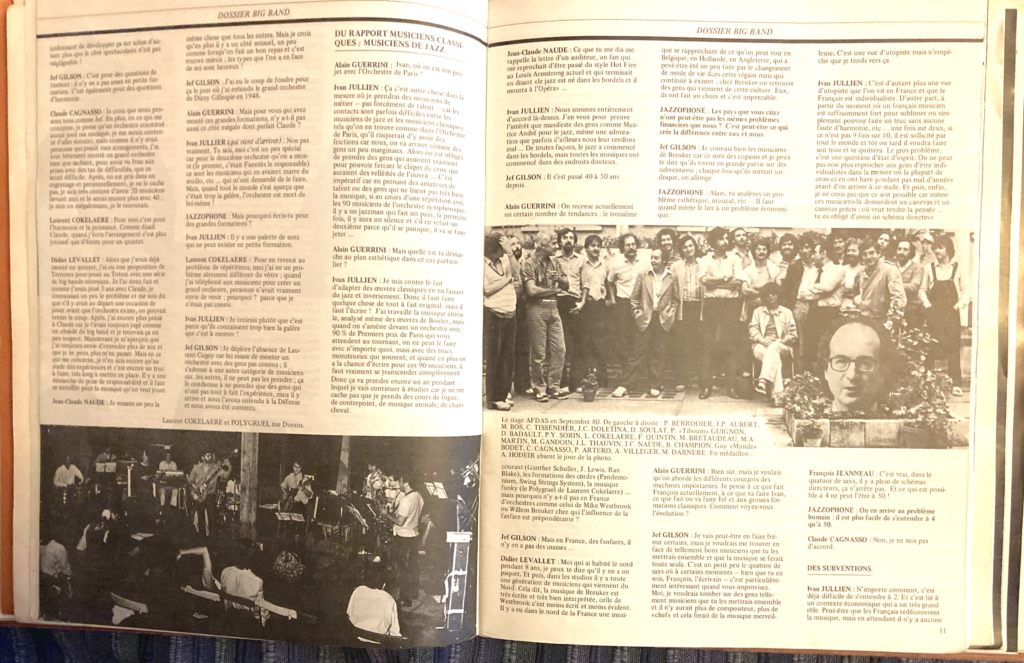
Un mois plus tard, le même Patrice Caratini qui doublait à la contrebasse au sein de Polygruel revient au (presque) tout acoustique en présentant son Onztet au Cim: 2 trompettes (Tony Russo, Éric Le Lann), 2 trombones (Jacques Bolognesi, Hamid Belhocine), 1 tuba (Marc Steckar), 2 saxes (Alain Hatot, Patrice Bourgoin), 1 guitare électrique (Marc Fosset), 1 contrebasse (Cara), une batterie (Umberto Pagnini) et une paire de congas (Michel Delaporte).
En stage
Auparavant, en 1979, un autre événement avait eu son importance : le stage de big band organisé par Alain Guerrini sous l’égide de l’Afdas (Assurance formation des activités du spectacle, créé en 1972 par celui, grand amateur de jazz, qui n’allait pas tarder à devenir le ministre de l’économie et des finances de François Mitterand, Jacques Delors à l’origine en 1971 dans le gouvernement de Jacques Chaban Delmas d’une loi fondatrice portant son nom, sur la formation professionnelle).
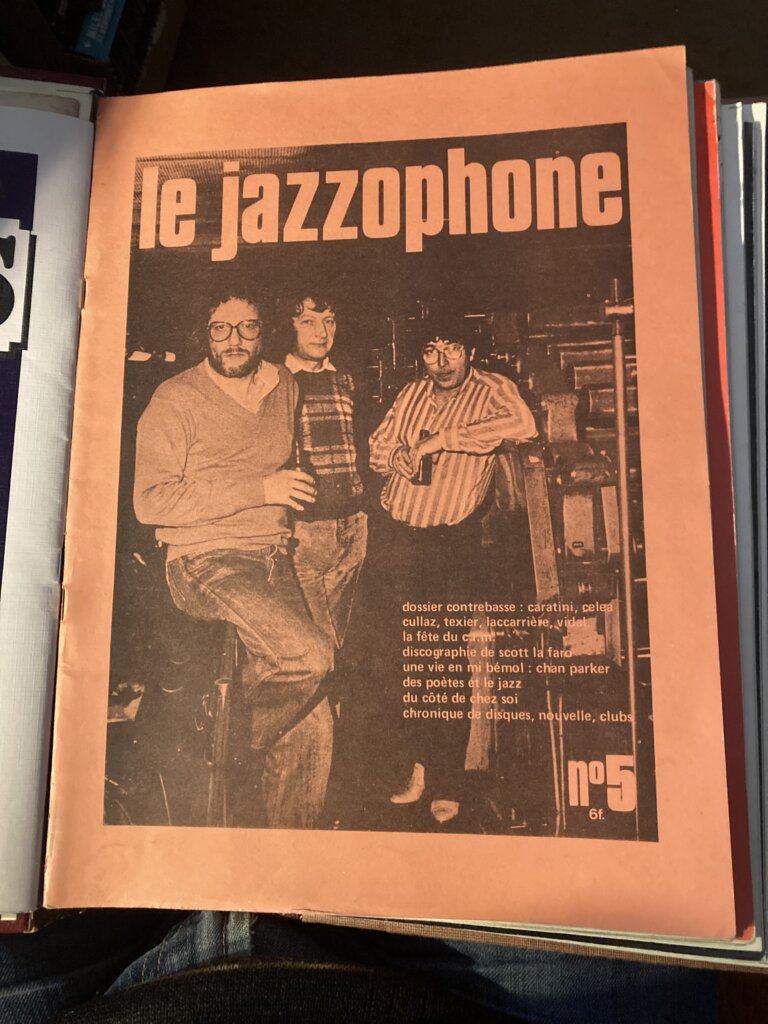
Placé sous la direction pédagogique de Roger Guérin, Jef Gilson, Claude Cagnasso et Ivan Jullien, ce stage s’était tenu du 3 au 28 septembre au CIM, avec trois concerts le 17 à l’Espace Cardin produit par Radio France (donc André Francis au bureau du jazz), le 27 au Siem et un autre concert donné au pied des rotatives du journal Le Monde le 25 octobre. À cette époque, préparant l’ouverture de la Discothèque municipale de Montrouge, je profitais de mes lundis libres pour monter au Cim que je commençais à fréquenter assidument, pour me glisser dans les salles de répétition et m’initier au jargon, aux ficelles, aux rites du big band : l’existence d’un premier trompette que l’arrangeur devait ménager en le dispensant de solo ; la complicité du premier trompette avec le pied de grosse caisse du batteur ; l’importance du premier alto, celle pourtant fort ingrate et également exigeante de deuxième alto ; l’aristocratie de la section de trombones, discrets lorsque trompettes et saxophones rivalisaient de traits rapides ou d’explosions dans l’aigu, mais au cœur de l’orchestre et de l’arrangement vécu de l’intérieur… À ces trombones, on leur aurait confié les clés de sa voiture et son appartement sans leur demander leur identité. Je me souviens aussi avoir entendu Roger Guérin s’étonner et s’agacer de ce que les jeunes solistes se refusaient au rituel, consistant à venir prendre son solo « devant » l’orchestre (s’extraire de son pupitre, descendre du praticable notamment lorsque l’on est perché parmi les trompettes, s’exposer « devant », face au public). Cette expression à laquelle Roger semblait tenir m’est restée : « aller/venir devant. Y aller, se projeter. »
Stage et renouveau
Dans son éditorial du numéro 8 du Jazzophone (le journal du Cim, automne 1980), sortant du concert de l’orchestre de Solal au Tep, Alain Guerrini écrivait : « Le goût pour le Big-Band [sic] semble être un phénomène nouveau du côté des musiciens aussi bien que de celui des auditeurs : Carla Bley au festival de Paris [typique de ces big bands qui n’en étaient pas], les six big bands au festival du Théâtre présent*, la découverte de Laurent Cugny et son orchestre Lumière [récent lauréat du Concours national de jazz de la Défense], les stages de l’Afdas, les 30 ou 40 formations amateurs permanentes disséminées dans toute la France, La Marmite infernale de l’Arfi à Lyon, tout un mouvement que les pouvoirs publics devraient prendre en compte et soutenir financièrement, car un grand orchestre, cela coûte cher. C’est pourquoi, dans ce numéro, il est surtout question de Big-band tant à l’occasion de la Table ronde que dans l’interview de Roger Guérin. » François Mitterand attend son heure, et avec lui Jacques Lang, Maurice Fleuret… bientôt un Orchestre national de jazz ; qui ne satisfera pas tout le monde. Rendez-vous en 1986…

Cette année-là, du 31 août au 2 octobre, le stage de l’Afdas se tint au Cim avec la participation pédagogique, à tour de rôle une semaine chacun, de Martial Solal, Sonny Grey, Ivan Jullien et le tout jeune Denis Badault (prix de soliste au Concours de la Défense en juin 1979) pour la direction musicale, plus François Nowack du syndicat des musiciens pour la partie gestion d’un orchestre, Derry Hall, François Jeanneau et Ivan Jullien pour des cours d’arrangement, plus des ateliers de direction de section, de technique de l’improvisation, de petites et moyennes formations et des écoutes de disques commentées. Dans le dossier de quatre pages publié dans le numéo 11 du Jazzophone,citons quelques figures sous la rubrique “chefs de section” : Tony Russo, Kako Bessot, Philippe Maté, Jean-Louis Chautemps, Patrice Caratini, Cesarius Alvim, Tony Bonfils. Et parmi les stagiaires : François Chassagnite, Peter Volpe, Michel Camicas (pourtant dans le métier depuis 1955 chez Maxime Saury et pupitre chez Jacques Danjean dès 1961, omniprésent des sections de trombones dans les années 1970), Richard Foy, Pierre Mimran, Jean-Pierre Solvès, Lionel Benhamou, Kahlil Chahine, Laurent Cokelaere, Marc-Michel Le Bévillon, Amaury Blanchard, Jean-Michel Davis. Plus en arrangement : François Biensan, Francis Cournet, Pierre-Yves Sorin, Claude Tissendier, André Villéger… D’autres noms ressortent du compte rendu de Jazz Magazine en novembre (n°291): Patrick Artero, Jean-Pierre Aupert, Denis Badault (mentionné là comme stagiaire, mais n’a-t-il pas que 22 ans), Laurent Cokelaere (cette fois-ci comme formateur), Marie-Ange Martin, Guy Hayat, Pierre Guignon (“Ti’Boum”).
Jean-Claude Naude apparaît encore parmi les formateurs ainsi qu’André Hodeir que je me souviens avoir croisé au Cim à cette occasion et qui semble avoir participé avec Solal au travail sur ses arrangements des thèmes de Thelonious Monk (Crepuscule with Nellie et Coming on the Hudson qui seront au répertoire de l’album “Martial Solal et son orchestre joue André Hodeir”, live à la Maison de la radio au printemps 1984).
À l’époque de ces stages Afdas, je n’avais hélas pas d’appareil photo, mais c’est dans cette émergence qu’il convient de replacer ces quelques images du big band de Martial Solal le 30 janvier 1981 à la Chapelle des Lombards.
* Du 29 octobre au 6 novembre, on avait pu y entendre du swing au jazz afro-cubain, du jazz-rock au free le Swing Limited Corporation, le big band du lundi du CIM dirigé par Claude Cagnasso, le Onztet de Patrice Caratini, le Polygruel de Cokelaere le Didier Levallet Big Band, le Celestrial Communication Orchestra d’Alan Silva.
Le 25 septembre 2021, Martial Solal, qui nous a quittés hier, avait accordé à Jazz Magazine un entretien exceptionnel. Le voici réédité pour la première fois en son honneur.
Ce n’était évidemment pas la première fois que Martial Solal accordait une interview à Jazz Magazine, lui qui avait déjà 27 ans en décembre 1954 quand paru notre tout premier numéro. Alors, quand son agent Martine Palmé nous appela à l’occasion de la création de son nouveau concerto pour piano pour nous proposer de le rencontrer, on lui répondit oui, bien sûr, mais en cherchant tout de suite un “angle” différent. « Et pourquoi pas, chère Martine, venir à plusieurs, façon conférence de presse ? » Transmise à l’intéressé, l’idée lui plut immédiatement.
Le 25 septembre 2021, face à Franck Bergerot, Stéphane Ollivier, Lionel Eskenazi, Fred Goaty et les deux benjamins de la bande, Walden Gauthier (17 ans) et Yazid Kouloughli (30 ans), Martial Solal s’était livré comme rarement, trônant au beau milieu de son salon, à côté de son piano dont, hélas, il ne jouait plus. C’est peu dire que ce fut pour nous tous un moment merveilleux dont nous nous souviendrons longtemps.
Merci à Anna Solal, la femme de Martial, merci à Martine Palmé (souvenir ému de ses macarons faits maison !) et merci Monsieur Solal auquel, à peine ce grand entretien terminé, nous avions donné rendez-vous pour “L’interview des 100 ans”, en août 2027, pour notre n° 812. Hélas…
Fred Goaty : Pour le dossier Miles Davis du numéro que nous venons de boucler, nous avons retrouvé dans Jazz Magazine une chronique de “Miles Ahead” rédigée par vos soins, en juillet 1958 !
Martial Solal Je me sentais vraiment en forme à cette époque, avec l’envie de tout dévorer, je n’ai jamais ressenti la même chose ! Je me sentais bien dans ma peau, avec l’impression de ne même pas sentir son corps…
Fred Goaty : C’est à dire ?
Aucun mouvement ne me coûtait, il n’y avait pas d’effort à faire pour exister. Ça doit être encore mieux plus jeune, mais je n’avais pas réalisé. J’ai cru être vieux à 30 ans, j’ai voulu refaire ma vie, et j’ai divorcé ! [Rires]
Walden Gauthier : J’ai découvert le jazz à environ 15 ans, surtout à travers le piano. Je crois que vous aussi aviez découvert le piano à cet âge. D’où vous vient cette passion ?
Je vais engueuler Martine [Palmé, NDLR], car j’avais demandé qu’on ne me pose pas de questions que j’ai entendues trois mille fois ! Mais vous êtes jeune, vous êtes pardonné. J’ai grandi à Alger. On voyait la mer de notre balcon, ça ne s’oublie pas. On n’avait qu’une seule radio, où j’ai entendu des gens comme Rina Ketty, des chansons, et parfois un concert classique. Le dimanche aprèsmidi, mes parents m’emmenaient aux Bains Nelson. Là jouait un orchestre de cinq musiciens dont l’un, voisin de palier d’une de mes tantes, jouait très bien du piano – sur un instrument désaccordé à un point qu’on ne peut pas imaginer –, de la batterie, du saxophone, de l’accordéon, tout ! Il était fanatique de Ben Webster, les prémices du “middle jazz”. Ce jour-là, il jouait Marinella, le tube de Tino Rossi. Tout d’un coup, il a changé quelques notes, puis s’est mis à improviser sur la mélodie. Moi qui apprenais le piano classique, j’ignorais qu’on avait le droit de faire ça. Je suis devenu son élève. Il m’a même engagé dans son orchestre, je me souviens que mon premier cachet était de 20 francs de l’époque, ce qui devait permettre d’acheter au moins un paquet de cigarettes ! Ensuite j’ai travaillé seul, je n’ai pas beaucoup écouté de disques mais suffisamment pour savoir qui est qui. C’était en 1942, et je me souviens de l’arrivée des alliés, le 8 novembre.
Stéphane Ollivier : Ce qui vous fascine d’emblée dans le jazz, plus encore que le rythme, c’est donc l’improvisation, l’idée même qu’on puisse changer des notes ?
C’était la liberté ! Et c’était beau, c’était beaucoup mieux que Marinella, ce qui est facile…
Franck Bergerot : Changer les notes c’est aussi changer leur place ?
On en n’était pas encore là. C’était une broderie, une paraphrase plus ou moins intelligente. Mais le jazz était nouveau. Et puis être musicien, ce n’était pas un métier.
Fred Goaty : C’est votre big bang, la petite étincelle qui va provoquer quelque chose de très grand ! Vous dites que les disques n’étaient pas si importants, c’étaient des 78-tours à l’époque…
Oui, et j’en ai gardé un que j’ai cassé et recollé, je vais vous le montrer, vous serez parmi les premiers à le voir !
Fred Goaty [En examinant le disque] : Martial Solal Trio, avec Jean-Marie Ingrande, Jean-Louis Vialle, The Champ de Dizzy Gillespie, sur la marque Swing, évidemment. C’est un de vos premiers ?
Je ne savais pas ce qu’étaient les 78-tours à l’époque, je ne faisais qu’écouter, et l’idée de faire un disque ne m’était pas venue. Avant mes premiers disques, j’avais fait mes preuves au Club Saint-Germain, dans l’orchestre de Tony Proteau, un magnifique fou qui adorait le jazz et avait monté un big band qui jouait tous les dimanches matin à l’Alhambra. Un jour, André Francis me dit : « Tu ne voudrais pas faire un disque ? » C’est comme s’il m’avait dit « tu ne voudrais pas le billet gagnant de la loterie ? » [Rires.] Evidemment j’ai dit oui, et j’ai signé un contrat d’exclusivité pour huit ans sur le label Vogue, dirigé par Léon Cabat. J’étais le jeune en qui on plaçait beaucoup d’espoirs.
Stéphane Ollivier : Vous étiez alors pianiste attitré du Club Saint- Germain ?
Pas tout à fait encore, j’ai attendu que Bernard Peiffer décide de s’en aller pour prendre sa place. C’était le pianiste le plus en vue à ce moment-là, on était très copains. On a fait de nombreuses soirées à quatre mains sur un piano droit, dans un club qui s’appelait Agnès Capri, du nom de la chanteuse de café-théâtre. Bernard a voulu tenter sa chance aux États-Unis et a bien réussi, mais il est mort beaucoup trop jeune. Mais c’est une autre histoire et on ne va pas sauter du coq à l’âne, ni des macarons aux calissons. Je signale au passage que les macarons sont dus à Madame ! [Martine Palmé, NDLR.]
Franck Bergerot : Bernard Peiffer a été une influence ?
Non, il était plus “middle-jazz” que moi. J’avais déjà des idées un peu farfelues pour l’époque. C’est à dire ne pas ressembler à ce qui se faisait, tout en copiant tout le monde ! [Rires.] Je connaissais ce qui existait mais n’arrivais pas à le faire aussi bien, alors je faisais autre chose. Longtemps, je me suis dit que je n’avais peut-être rien compris. Les pianistes de l’époque aimaient Horace Silver. Quand John Lewis venait faire le boeuf au Club Saint-Germain, ils étaient émerveillés de la façon dont il plaquait ses accords pour accompagner. Il faisait trois notes mais on bavait car c’était un grand nom. On est restés à la traîne des musiciens américains, car on a toujours cru, et beaucoup le croient encore, qu’ils sont au-dessus. Je me suis formé en les écoutant mais j’étais toujours un petit peu différent des autres. Sur ce disque-là [le 78-tours, NDLR], vous verrez qu’il y a l’essentiel du jazz traditionnel de l’époque mais qu’en même temps il y a une réalisation différente. Dans mes thèmes, il y avait déjà des arrangements, des introductions préparées, un travail de composition. A cause de ça, j’ai été moins aimé que je n’aurais aimé l’être…
Fred Goaty : Vous êtes l’un des pianistes les plus respectés sur la planète, en France vous êtes une sorte de monument, et vous auriez voulu être plus aimé ?!
Mais ça ne s’est pas fait du jour au lendemain !
Franck Bergerot : On a l’impression qu’il y a d’un côté l’histoire du jazz, et de l’autre Martial Solal. Dans les années 1960 par exemple, est-ce que des gens comme Bill Evans ou le second quintette de Miles Davis vous intéressaient ?
A partir d’un certain moment je n’écoutais plus personne. Je n’ai jamais vraiment acheté de disques. J’ai écouté Erroll Garner que j’aimais beaucoup, Teddy Wilson car il jouait avec Benny Goodman, à cause de qui j’ai acheté la clarinette qui est posée-là derrière-vous. 850 francs d’occasion à l’époque !
Fred Goaty : Vous vouliez vous mettre à la clarinette ?
Mais je m’y suis mis ! Je suis devenu clarinettiste pendant trois ou quatre ans, à tel point que quand j’ai fait mon service militaire, en 1947 au Maroc, j’étais allé avec mon innocence d’un type de 20 ans taper à la porte de Radio Maroc. J’avais réussi à décrocher une émission de radio à Alger, et Radio Maroc m’a proposé de former un petit ensemble. Le plus ancien de notre chambrée, qui avait un an de plus que nous – il était caporal et nous deuxième classe – jouait de l’accordéon très bien, on a dû engager un batteur de Rabat. On jouait toutes les semaines et j’ai été désigné clarinettiste. Mais comment on est-on arrivé là déjà ?
Franck Bergerot : Vous disiez qu’à une époque vous n’écoutiez plus personne. Quand précisément ?
Assez tôt.
Stéphane Ollivier : Plus tard, au Club Saint-Germain, vous accompagnez tous les grands musiciens de passage…
Oui je les connaissais mais je ne les écoutais pas. Certains disent qu’il faut connaître l’œuvre des autres, mais j’étais limité. Une anecdote au passage : quand Bernard Peiffer est parti aux États-Unis, le patron du club m’avait proposé de le remplacer. Il m’a demandé ce que j’allais leur jouer, j’ai dit du Chopin, du Bach, un thème de Ravel avec lequel Bernard avait eu un succès monstre. Il me demande si je vais aussi jouer du jazz : il m’avait fait marcher, et j’avais foncé dedans en citant les classiques que j’aurais d’ailleurs été incapable de bien jouer ! J’ai poussé un grand ouf de soulagement.
Yazid Kouloughli Qu’est ce que représente le Club Saint-Germain pour vous à l’époque ?
On disait que c’était le temple du jazz. Ma première sortie à Paris, c’était pour m’y rendre. Il y avait un portier, et on ne laissait pas entrer n’importe qui, il fallait être reconnu, ou un client venu dépenser son argent. Un soupirail donnait sur une rue adjacente et j’écoutais comme ça. On entendait Claude Bolling, Jean-Louis Chautemps, et le batteur Roger Paraboschi, qui était peut-être le doyen des musiciens de jazz de cette époque, qui jouait avec Django Reinhardt…
Lionel Eskenazi : C’est au Club Saint-Germain que vous avez créé votre trio avec Pierre Michelot et Kenny Clarke ?
Ce n’était pas mon trio, mais le trio maison. Il y a eu d’abord Barney Wilen, qui avait 17 ans et qui jouait formidablement, comme un type de 40 ans. Il a pris la grosse tête un peu trop jeune, il nous snobait presque, Kenny Clarke, Michelot et moi. Le public n’en avait que pour lui, jeune, sympathique, avec un nom américain…
Fred Goaty : Ça parait irréel aujourd’hui : vous jouiez tous les soirs au Club Saint-Germain…
Je crois être le musicien au monde qui a le plus fait de choses. Beaucoup ont enregistré des disques, écrit des concertos, mais personne n’a en plus séjourné dix ans dans des clubs, ça n’existait pas à l’époque. Il y avait le Club Saint-Germain et le Blue Note, et je partageais mon temps entre les deux.
Fred Goaty : Vous aviez un contrat ?
On était engagé et payé au jour le jour, quand la caissière avait enfin fini ses comptes pour voir si elle pouvait nous payer, contrairement au Agnès Capri, où on avait joué plusieurs jours sans être payés, car il n’y avait pas de public.
Fred Goaty : C’était déclaré tout ça ?
On nous donnait des feuilles de paye, mais un beau jour, ne sachant pas que ça pouvait servir, j’ai tout jeté. Et le jour où je suis allé à la Sécurité Sociale pour demander à prendre ma retraite, ils n’avaient plus de trace, comme si je n’avais rien fait alors que je n’ai jamais arrêté de travailler ! Alors j’ai une pauvre retraite… Mais enfin ça va ! [Rires.]
Fred Goaty : Quand on est pianiste du Club Saint-Germain, on est jalousé ?
Je ne sais pas ce que les autres avaient dans la tête, mais la jalousie fait partie des choses normales. Moi aussi j’ai jalousé Peiffer avant d’y être.
Stéphane Ollivier : Vous êtes dès ce moment-là considéré comme un peu farfelu, moderniste, mais vous enregistrez vos premiers disques avec Sidney Bechet et Django Reinhardt. Comment cela se fait-il ?
Si je n’avais pu faire que des choses comme ça j’aurais été au paradis, mais j’en ai fait de bien plus minables. Avant le Club Saint-Germain, j’ai été pianiste de bar, figurant dans un film de Maurice Chevalier… Il faut manger pour vivre, je n’avais pas un appétit formidable, mais tout de même. Pour Sidney Bechet, c’est parce qu’on était tous deux en contrat chez Vogue, lui en était l’un des piliers, qui faisait casser les fauteuils de l’Olympia, comme les rockeurs, plus tard. Il y avait déjà cet antagonisme entre les anciens et les modernes. Les conceptions de Charlie Parker ont révolutionné ce qui avait été fait avant. Tout le monde essayait de jouer comme lui, sauf moi qui ne l’écoutais pas trop. Je pensais que tous les jazz pouvaient marcher ensemble, et j’ai proposé de faire un disque avec Bechet. Il a tout de suite accepté, il était très content. On avait Kenny Clarke à la batterie, ce qui est rassurant. Cette séance a duré trois heures, que des standards qu’on connaissait tous les deux. J’ai joué comme je savais. Je ne me souviens pas avoir fait trop d’accords dissonants, dont je n’en connaissais pas encore beaucoup de toute façon. Pour Django, j’ai bénéficié de la maladie de Maurice Vander qui avait fait une partie de la séance, et Django, qui m’avait entendu dans un club, avait demandé que je le remplace. C’est passé comme une lettre à la poste. J’ai fait la séance avec Django dans mon dos, donc j’avais moins le trac ! On a fait quatre ou cinq disques de classiques usés, que tout le monde connaît, c’était très facile. Je n’ai pas gardé un très bon souvenir de mon jeu, mais en le réécoutant ce n’était pas si mal. Mais tout ça ce sont des circonstances anormales. Et puis ce n’était pas comme maintenant, où il y a trois mille pianistes, à l’époque on avait moins de mérite : il suffisait que l’un soit malade, ou l’autre déjà occupé…
Yazid Kouloughli : Vous avez côtoyé Django ensuite ?
Il a eu l’imbécilité de mourir presque juste après… On s’était vu cinq ou six fois dans les clubs, je me souviens qu’il s’était installé près du piano un soir, mais j’étais trop intimidé pour lui parler. Tout le monde rêvait de devenir Django. Quand il arrivait, pour un peu on se mettait au garde à vous ! Il a créé une chose anormale par rapport à Charlie Parker, et qui a duré. Mais dans son dernier disque, celui que nous avons fait ensemble, il était déjà accro à Parker, inconsciemment, et on y entend ce qu’il aurait pu devenir. Je suis sûr qu’il aurait adoré nous faire profiter de son interprétation de cette nouvelle musique.
Lionel Eskenazi : Nous sommes donc en 1953, c’est à ce moment-là que vous commencez à faire votre propre musique ?
Même dans le premier disque, on peut dire que c’était ma propre musique, très inspirée de celles des autres. Il y avait quelque chose qui allait finir par être un peu différent. Mais je n’ai jamais mis au rebut ce qui existait ! Je m’en suis inspiré pour étoffer, ou choisir une autre direction. Sans mes prédécesseurs je ne serais rien, et je n’aurais pas pu vous offrir de l’Orangina aujourd’hui !
Walden Gauthier : Quels sont ceux que vous avez toujours aimé ?
J’aimais ceux qui savaient bien jouer de leur instrument. Chez les pianistes, Teddy Wilson, Erroll Garner, Bud Powell et John Lewis, avec qui je suis devenu assez ami et fait beaucoup de concerts en duo par la suite. Horace Silver aussi, dont j’étais un peu jaloux car tout le monde ne jurait que par lui !
Stéphane Ollivier : Et en dehors des pianistes ?
Lester Young, à qui Stan Getz qui a tout piqué – mis à part la sonorité –, dans le sentiment, et même dans les phrases. Comme Lee Konitz d’ailleurs.
Lionel Eskenazi : Vous n’avez pas cité Art Tatum…
Je l’ai connu bien plus tard ! C’était trop dur pour que j’essaye de le copier. Mais je me suis dit que c’est comme ça qu’il fallait jouer. J’avais aussi entendu un disque à deux pianos, je ne sais plus qui jouait les graves, mais les aigus c’était Lionel Hampton, qui jouait comme d’un vibraphone, chacun faisant des choses infaisables pour un pianiste seul. Mais pensant qu’il n’y avait qu’un seul instrumentiste, je me suis dit que c’est ça qu’il fallait que je fasse. C’était comme un rêve qui m’a donné l’envie de mieux jouer du piano.
Franck Bergerot : Quand vous faites la Suite en ré bémol en 1959 et que naît ce trio régulier avec Gilbert Rovère et Daniel Humair, vous jouez moins au Club Saint-Germain et plus en trio ?
Non, car les “concerts”, les tournées, ça n’existait pas à l’époque. D’ailleurs, on ne disait pas concert mais “gala”. La Suite en ré bémol a été un tournant pour moi, mais aussi en général, car rien n’existait de ce genre-là, avec plusieurs thèmes imbriqués. Les pauvres danseurs du Club Saint-Germain s’arrêtaient tout le temps, car on passait de la ballade au tempo rapide…
Fred Goaty [À Yazid Kouloughli et Walden Gauthier] : Ça ne vous paraît pas fou qu’on danse aux concerts de jazz ?
Yazid Kouloughli Si on parle de la musique de Charlie Parker je peux comprendre mais sinon, non…
Fred Goaty [À Martial Solal] : Est-ce que le fait que les gens arrêtent de danser a changé votre musique ?
Ce n’est pas la musique qui a fait que les gens dansent ou non, mais la multiplication des festivals et des concerts. C’est peut-être lié aux premières Maisons de la Culture créées par André Malraux… Les festivals naissaient dans toutes les villes, de fauché, on commençait à avoir l’espoir de gagner un peu notre vie. Les concerts ont complètement modifié nos vies.
Stéphane Ollivier : Dans les années 1960, vous imaginez une conception du trio avec des arrangements et des formes nouvelles, tandis qu’au même moment, aux États-Unis, c’est beaucoup plus libre, avec des dialogues improvisés. Vous aviez écouté Scott LaFaro avec Bill Evans, ou les premiers disques de Paul Bley ?
Scott LaFaro a été le premier contrebassiste à jouer beaucoup de notes, et vite, avec plusieurs doigts, c’est ce qui a fait que ce trio a fait un tabac énorme, ce qui leur a valu des copieurs dans le monde entier. Bill Evans avait un sens harmonique peu courant à l’époque. Ma conception n’y est pas liée, car je n’écoutais pas spécialement ce trio, et je n’avais pas un bassiste qui jouait aussi vite que LaFaro ! Il fallait s’adapter…
Fred Goaty : La manière dont vous parlez de Scott LaFaro donne l’impression que vous auriez bien aimé jouer avec lui…
Sûrement, oui. Il n’y avait pas d’équivalent en Europe avant Niels-Henning Ørsted-Pedersen, qui jouait encore beaucoup plus vite : à 16 ans, il venait faire le boeuf au Blue Note et connaissait tout le bebop par cœur, avec des fautes d’harmonies qu’on lui pardonnait facilement tant il jouait bien. Plus tard, quand il a joué avec Oscar Peterson, l’harmonie était relativement simple, mais c’était le bop dans toute sa splendeur, comme avec Ella Fitzgerald. Je ne sais pas si c’est eux qui ont lancé la mode des citations dans les chorus, mais j’ai attrapé cette maladie, et j’ai dû me faire vacciner contre ! [Rires.]
Lionel Eskenazi : En 1963 le producteur George Wein vous invite à jouer à New York…
Oui, c’était incroyable. Aucun Français n’allait à New York, car il fallait y connaître des gens pour se loger, avoir un passeport pour y travailler. J’ai reçu un télégramme un soir au Club Saint-Germain pour mon engagement au Festival de Newport, avec deux semaines dans un club avant, sans savoir si on me paierait le voyage. Mais j’étais tellement content que j’aurais vendu ma chemise pour y aller ! J’ai rencontré plein de gens, dont Bill Evans qui, vu que j’avais la même rythmique que lui [Teddy Kotick à la basse et Paul Motian à la batterie, NDR], m’avait dit : « Il paraît qu’on joue un peu pareil tous les deux. » Ça n’était pas vrai du tout, mais c’était gentil de sa part. On a finalement passé quatre semaines dans ce club où nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons eu des articles. Là-bas, les musiciens sont pris en charge par un producteur et les plus importants ont un personal manager, qui ne travaille que pour trois ou quatre personnes. J’ai eu la chance de me retrouver dans le bureau de Joe Glaser, le producteur de Louis Armstrong et de Duke Ellington. Mais à la fin de mon séjour, son tarif m’a filé un sacré coup !
Lionel Eskenazi : C’est à cette époque que vous rencontrez Thelonious Monk à San Francisco ?
C’était l’année suivante, mais on ne s’est pas vraiment rencontrés, on s’est vus. On jouait dans la même rue, où il n’y avait que des clubs de jazz.
Stéphane Ollivier : Comment perceviez-vous sa musique ?
C’était génial ! Je crois qu’Ahmad Jamal jouait en face, Johnny Griffin jouait avec Monk à cette époque, il y avait une émulation constante, une joie de faire tout ça. Et puis j’étais jeune, je voyais tout avec des yeux différents…
Fred Goaty : Vous parliez bien anglais ?
Mal, mais j’apprenais un petit peu. Mon personal manager avait cette manie de téléphoner à un journaliste différent à chaque carrefour où il s’arrêtait, et j’ai eu des interviews presque tous les jours. Je croyais être le Pape, avant de me rendre compte que je n’étais qu’un porteur de cierges de troisième catégorie !
Yazid Koulouhli : Quand vous jouiez avec ces musiciens, vous leur apportiez des partitions ?
Dans la plupart des cas c’était du par cœur. Ça n’existait pas les partitions à l’époque, tout le monde ne jouait que d’oreille, à partir des disques, avec des fausses notes parfois.
Franck Bergerot : Quand vous jouiez vos suites des années 1960, vous aviez bien des partitions…
Ce n’est arrivé que bien après, quand je les ai enregistrées et déposées à la Sacem, bien après l’écriture de la Suite en Mi bémol ou de la Suite pour une frise. Et quand je l’ai jouée avec Teddy Kotick à New York, il l’avait apprise par cœur. Le souci majeur des musiciens était la forme. Avec le recul c’est incroyable qu’ils aient réussi à apprendre ça aussi vite ! Pareil pour la Suite sans tambour ni trompette. Il n’y a que les pièces pour big band que j’ai dû écrire. C’est que j’ai toujours rêvé d’être compositeur, depuis mes 18 ans, plus qu’improvisateur. Dès le milieu des années 1950 j’ai eu des orchestres, et puis le cinéma est arrivé là-dessus. J’ai eu une carrière assez chargée. D’ailleurs je suis très fatigué !
Stéphane Ollivier : En termes de composition, qu’est-ce que le cinéma vous a appris ?
J’ai pu écrire pour un ensemble de cordes, moi qui n’avais jamais écrit que pour des cuivres, pour donner un côté sentimental, peut-être inspiré des bandes son de grands films américains signées Dimitri Tiomkin. C’était infiniment plus facile avec les cordes – plus proches du piano – que les cuivres, qui demandent une certaine expérience. Le premier a été À bout de souffle, en 1960. Pendant deux ou trois ans, je suis devenu la coqueluche du cinéma, puis du jour au lendemain, plus rien ! La mode du jazz était passée, Ennio Morricone est devenu le chouchou des metteurs en scène. En France, il y a eu des gens à la mode pendant quelques années, certains ont duré, comme Michel Legrand ou Vladimir Cosma, Michel Portal. J’ai fait un disque avec Michel Magne, qui faisait écrire tous ses arrangements par Hubert Rostaing. Il n’inventait que la mélodie, et l’arrangeur faisait tout le travail. C’est courant.
Yazid Kouloughli : Est-ce que vous aviez la liberté que vous souhaitiez ?
Oui, ils m’ont toujours foutu la paix. C’est un jeu d’enfant, croyez-moi ! C’est agréable à faire, c’est mieux payé que tout le reste, et comme la plupart des metteurs en scène ne connaissent rien en musique, ils vous laissent faire. Le premier avec qui j’ai travaillé, c’était Jean-Luc Godard – c’est Jean-Pierre Melville qui lui avait parlé de moi. Godard n’a d’ailleurs pas fait beaucoup de progrès en musique… On s’est rencontrés pour discuter, et il m’a dit : « Mettez un banjo, ce serait bien ! » Ce que je n’ai évidemment pas fait !
Fred Goaty : Jean-Pierre Melville aimait beaucoup la musique…
Oui, il était très exigeant, j’ai eu beaucoup de mal à travailler avec lui, et on a été fâchés pendant quelques temps. Il m’avait demandé de faire des essais pour Le Doulos, mais rien ne lui plaisait. Avec Roger Guérin, on avait même enregistré une maquette pour lui, où on jouait complètement free, alors que ça n’existait pas encore. Quand on engage un musicien, c’est pour qu’il ajoute quelque chose, qu’il traduise ce qu’il voit en musique !
Fred Goaty : Donc, pas tant de liberté que ça finalement…
Au final, on est libre, car on nous laisse faire ce que l’on veut, mais j’ai rarement été réengagé par le même metteur en scène.
Lionel Eskenazi : En 2000, Bertrand Blier vous a engagé pour Les Acteurs…
On a eu de bons rapports très longtemps, il est souvent venu ici pour que je lui montre l’avancée de mon travail, il était très content de la musique. Je pensais qu’il allait m’engager dans tous ses prochains films, mais il ne m’a plus rappelé !
Lionel Eskenazi : Vous avez aussi joué en piano solo sur Feu Mathias Pascal de Marcel L’Herbier. Là, votre liberté est beaucoup plus grande…
Oui, complète ! Il y en a eu un autre aussi… Pour l’un d’entre eux, j’avais joué à l’étranger, notamment à Moscou, une fois. Le film se situait dans les années 1920-1930, ça m’avait inspiré de la musique contemporaine qui débutait dans ces années-là. Je ne suis pas très content de ce que j’ai fait, ce n’est pas un métier facile. Tout ce que j’ai entendu côté accompagnement au piano pour l’image est mauvais d’ailleurs.

Les heureux intervieweurs, avec Martine Palmé, Anna Solal
et le Maître. Photo : Jean-Baptiste Millot.
Stéphane Ollivier : Vous avez employé tout à l’heure le mot “free”. C’est une musique avec laquelle vous n’avez pas été très tendre !
J’avais assisté à un concert d’Ornette Coleman en Allemagne. Il jouait du violon et de la trompette, et mal comme ce n’est pas permis ! La liberté, c’est bien mais il faut un minimum de choses ! Je n’étais pas prêt pour rompre avec le passé, quitte à ajouter des choses. Construire une maison en démolissant les fondations ne me semblait pas la solution. Ce n’est pas Ornette Coleman, mais ses suiveurs qui m’ont fâché avec le free jazz, tous ceux qui se sont dit qu’on n’avait pas besoin d’être un vrai musicien pour jouer.
Stéphane Ollivier : On a placé dans la même catégorie des gens qui faisaient des choses très différentes, entre Eric Dolphy, Albert Ayler ou Sunny Murray. Y a t-il des gens qui étaient catalogués “free” qui ont trouvé grâce à vos oreilles ?
Je pensais que ça ne pouvait pas être une musique de l’avenir, mais une parenthèse, nécessaire certainement, pour remuer les choses. Ça m’a influencé dans mes compositions. A mon époque, le tempo était omniprésent, et on s’est mis à pouvoir faire des passages avec des ralentis, sans harmonies, la musique devenait plus riche.
Fred Goaty : Ce que vous dites du free ressemble à ce que disait Miles Davis, qui s’en méfiait tout en étant attiré, et qui a admis que des musiciens intéressants en étaient sortis. Miles est l’un de vos contemporains : que représentait-il pour vous ?
Quand il jouait avec Charlie Parker c’était merveilleux. J’ai cessé de m’y intéresser quand il ne jouait plus du tout de standards. J’étais allé l’écouter – avec Lee Konitz – après son retour, dans les années 1980. Mais il n’a jamais perdu sa sonorité, et son feeling incroyable.
Lionel Eskenazi : Vous venez d’évoquer Lee Konitz, qui a été très important pour vous…
Je suis celui qui a joué le plus longtemps avec lui, des centaines de concerts aux États-Unis, et ailleurs. Ç’a démarré en 1968 lors d’un bœuf au Club Saint-Germain, et quelques mois après on jouait au même concert. Nous avions le même passé, les mêmes souvenirs, et on connaissait les standards habituels. Il jouait des notes à l’époque, ensuite il en jouait tellement peu que c’était plus du sentiment. Il était très influencé par Lennie Tristano, comme vous savez.
Fred Goaty : On a l’impression que vous aviez le même sens de l’humour aussi, un peu acide, décalé…
Oui, sans doute, mais les musiciens sont souvent comme ça. Michel Portal aussi a toujours été très amusant. On ne se prend pas au sérieux, on a gardé en tête que faire de la musique, n’est pas un métier !
Stéphane Ollivier : Cet humour s’entend dans votre musique, vos détournements de la forme, alors que chez Michel Portal, non !
Cet humour dans la forme, ce n’est pas de ma faute, c’est venu comme ça, je n’y peux rien. La seule chose que j’ai de différent c’est l’envie de savoir jouer du piano que j’ai beaucoup travaillé, mais la musique est dans la tête. Quand on sait qu’on peut jouer n’importe quoi, les idées arrivent.
Lionel Eskenazi : Vous avez aussi rendu un Hommage à Tex Avery…
Oui, j’aimais beaucoup ça, mais c’était surtout pour trouver un titre à la musique ! Comme j’avais trouvé le titre Jazz frit a l’époque du free jazz, un peu pour montrer mon désaccord… Mais je l’ai pratiqué aussi : avec Portal, on a joué free pendant quinze ans, si j’avais détesté ça je ne l’aurais pas fait. Mais mon truc, c’est avant tout l’harmonie issue de Claude Debussy et Maurice Ravel, toute cette époque. C’est la richesse de la musique. Même avant le free, lorsque tout le monde jouait modal, l’harmonie avait déjà un peu été mise de côté d’ailleurs.
Stéphane Ollivier : Ce goût pour l’harmonie et la forme vous a conduit à jouer longtemps en big band, mais aussi a écrire des pièces comme des concertos. Quelles sont vos références ?
C’est la faute d’André Francis ça. Il était fou ce type ! [Rires.] Un jour, il m’a proposé d’écrire un concerto de piano pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça m’a plu, et j’en ai fait cinq ou six. Ensuite j’ai écrit pour trompette, saxophone, sans plus penser à moi. Mon ambition était d’enrichir le jazz grâce a ce qui existait depuis des siècles. L’année dernière, à Radio France, il y a eu un concert de pièces que j’ai écrites, des concertos de forme classique, avec des phrases qui n’appartiennent qu’au jazz, qu’un musicien classique n’aurait pas pu jouer. Je ne suis pas le seul à avoir tenté ça, il y a eu des mélanges désastreux que tout le monde trouvait géniaux, par Gunther Schuller par exemple, où Rolf Liebermann, qui avait fait un truc qui avait été encensé mais qui était insensé. Depuis quelques temps, je suis complètement largué sur ce front. Je ne connaissais pas les œuvres des autres, mais je sais qu’André Prévin était un formidable pianiste de jazz en même temps qu’un grand chef d’orchestre. Je suis sûr qu’il a écrit des pièces mais je ne les ai pas entendues.
Fred Goaty : La musique d’Igor Stravinsky devait vous intéresser aussi…
Beaucoup, mais c’était le jazz de son époque qui l’intéressait, et pas ce que le jazz était devenu au moment où j’ai arrêté ce genre de choses. D’ailleurs, pour savoir ce que le jazz est devenu il faut s’intéresser aux connaisseurs d’aujourd’hui ! [En s’adressant à Walden Gauthier et Yazid Kouloughli] Qu’est-ce que vous, vous appelez “jazz” par exemple ?
Walden Gauthier : S’il y a quelque chose qui n’a jamais changé dans le jazz, c’est le langage qui permet aux musiciens de communiquer. Mais est ce que “jazz” désigne une musique précise où juste cette communication ?
Yazid Kouloughli : Tous les jeunes musiciens à qui j’ai pu parler ont un rapport ambivalent avec ce mot. Ils sont souvent un peu mal à l’aise avec ce terme, et la question de savoir s’ils en font ou non ne les intéresse pas tellement… Selon moi, avant l’arrivée du free jazz, on était arrivé à une perfection telle dans notre domaine qu’il était devenu impossible d’aller plus loin. Il fallait faire autre chose. Ensuite il y a eu le free et tous ses dérivés, puis il a fallu là encore faire autre chose.
Fred Goaty : Vous écoutez de la musique à la radio ?
Ça m’arrive, mais ce que j’y entend est assez traditionnel. Mais je suis en dehors de la musique maintenant. Je ne suis pas fâché avec elle, mais j’ai tellement donné qu’après mon dernier concert, je n’ai plus touché à mon piano, sauf quand il y a eu cette proposition de mettre à jour mes concertos de musique symphonique : je me suis remis à jouer pour écrire.
Yazid Kouloughli : Depuis votre concert à la Salle Gaveau, vous ne jouez plus, même en privé ?
Je n’ai plus joué de piano, non.
Fred Goaty : Ça vous manque ?
[S’adressant à sa femme.] Combien de minutes est-ce que je joue par mois ?
Anna Solal : Très peu, c’est un désastre.
Fred Goaty : Pardonnez-moi si la question est indiscrète Martial, mais sont-ce pour des raisons physiques que vous ne pouvez plus jouer, ou par manque d’envie ?
Rien de physique, non, car quand je m’y remets je me dis « tiens, je sais encore jouer, il me reste un peu de doigts ! », même si après une longue interruption ils ne fonctionnent plus aussi bien. J’étais arrivé à un point ou techniquement je pouvais m’arrêter de jouer trois ans et savoir encore jouer. Mais c’est une grande dépense physique, il faut une énergie terrible pour jouer du piano, même si ça a l’air facile.
Fred Goaty : Vous jouez beaucoup dans votre tête ?
Oui, mais je n’y joue rien d’intéressant ! [Rires.] C’est un lieu commun que les tous les musiciens ont en tête les choses les plus stupides du monde : le dernier truc qu’on a entendu dans un film, une chanson qu’on déteste mais qui est là malgré nous.
Fred Goaty : Vous n’avez plus joué depuis combien de temps ?
J’ai joué la dernière fois quand ma petite fille est venue me rendre visite. J’avais pris l’habitude, quand j’entendais la voiture de son papa se garer, de me mettre à jouer tandis qu’elle courait vers moi pour m’embrasser. J’ai adoré ces moments-là. Mais si personne ne court après moi…
Franck Bergerot : A propos de ce qu’on a dans la tête, un beau standard, ça repose sur quoi ?
D’abord il faut que ça dure. La meilleure preuve que c’est un standard, c’est sa longévité. Ça repose sur une mélodie intéressante qui ne ressemble pas aux autres, avec en général certains écarts inattendus, une harmonisation inspirante pour l’improvisateur. Les grands standards sont ceux que j’ai continué à jouer bêtement car je n’arrive pas à les user, ils m’inspirent toujours. Mais beaucoup ont disparu. Quand je jouais dans les clubs j’en connaissais 3000 ! [Le guitariste] Jimmy Gourley avait un petit carnet avec les grilles harmoniques, sans les mélodies, qu’il connaissait par cœur. Je jouais les accords et lui la mélodie, puis on improvisait. Il en connaissait des centaines. Certaines choses de Gigi Gryce, de Benny Golson – qui avait plusieurs tubes que tout le monde jouait au Club Saint-Germain – ou de Billy Strayhorn sont tellement beaux qu’on ne s’en lasse jamais.
Franck Bergerot : Y a t-il des auteurs qui vous inspirent plus que d’autres, comme Cole Porter ou Duke Ellington ?
C’est vrai aussi pour Cole Porter ou George Gerswhin, mais ceux qui m’inspirent le plus sont moins connus, comme David Raksin qui a composé Laura, ou Stardust de Hoagy Carmichael, ou Stella By Starlight…
Fred Goaty : Pourquoi y a t-il si peu de standards écrits par des compositeurs européens ?
Stéphane Ollivier …à part Michel Legrand…
Peut-être Nuages, les Feuilles mortes, un ou deux thèmes de Charles Trenet, mais ils n’avaient pas autant de qualités harmoniques que les autres dont j’ai parlé.
Lionel Eskenazi : Comment vous est venue l’idée de déstructurer les standards ?
Oh c’est ma mauvaise humeur ça… Ou peut-être parce que je n’ai pas de mémoire. J’aimais bien mélanger les choses et quand j’avais un trou, je pouvais me rattraper en jouant un autre thème. J’avais des réflexes, et j’étais un bon conducteur de voiture aussi.
Fred Goaty : D’où l’un de vos pseudonymes, Jo Jaguar !
Ça c’était alimentaire, et j’ai toujours eu très faim ! Et longtemps manqué de quoi manger… La première fois que j’ai choisi mon cachet, j’avais 52 ans. Avant, je ne demandais pas ce qu’on allait me donner. Mon nom a grandi d’un coup, je ne sais pourquoi, et j’ai pu être payé beaucoup plus que la plupart des musiciens. J’ai honte de le dire, mais ça n’est pas de ma faute !
Lionel Eskenazi : On dit que vous n’avez eu qu’un seul élève : Manuel Rocheman. Qu’en est-il ?
C’est un peu une légende. C’est le seul que j’ai vu plusieurs fois de suite et qui me payait ses leçons, il a un talent harmonique peu commun. Mais j’ai reçu ici trente ou quarante pianistes qui ne sont pas venus prendre une leçon mais à qui j’en ai donné tout de même. Et j’ai fait beaucoup de masterclasses en Suisse, en Italie. L’enseignement c’est merveilleux, mais beaucoup de musiciens sont devenus enseignants pour gagner leur vie. Ça m’aurait plu de faire ça, j’étais assez doué. Enfin, là je suis en train de me lancer des fleurs… Si vous nous débarrassiez un peu de ces biscuits ?
Walden Gauthier : Comment faire écouter du jazz à mes camarades de classe ?
Si vous vouliez apprendre l’Histoire de France à vos amis, je vous dirais de commencer par Clovis et vous verrez après, mais il faut connaître l’histoire dans l’ordre chronologique pour percevoir les évolutions. Si vous commencez par le dernier chapitre, ils ne comprendront rien. Il faut de la patience, posséder les disques des meilleurs interprètes de chaque époque. Mais je ne sais pas si vous arriverez à les convaincre car si pour nous le jazz était nouveau, pour les jeunes d’aujourd’hui c’est ancien et c’est un handicap terrible. Il faut commencer par le début, disons Louis Armstrong pour simplifier. Il était unique, sans parler de sa voix qui faisait partie de son charme, et tout ce qu’il jouait à la trompette, sans une technique formidable, mais avec le génie de l’improvisation.
Yazid Kouloughli : Tout ce que vous mettiez dans vos improvisations et dans vos compositions, cet imaginaire musical, qu’est-ce que vous en faites désormais ?
Mes doigts ne vont plus répondre et handicaperaient mon imagination. Vous me demandez si je m’ennuie ? Non, pas du tout. Je fais des tas de choses… qui sont secrètes ! Ça n’intéresse pas les lecteurs de Jazz Magazine.
Fred Goaty : On pense à Keith Jarrett, qui ne peut plus jouer du tout suite à son accident cérébral…
Le côté physique est irremplaçable. C’est toujours triste. Tout ce qui n’est pas gai est triste ! [Rires.] Mon problème, c’est de bien marcher sans avoir de vertiges, j’ai des problèmes d’yeux… Cinquante mille problèmes !
Martine Palmé : Quel souvenir gardez-vous de vos rencontres avec Wes Montgomery ?
Très sympathique ! On a joué plusieurs jours à Hambourg. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Jimmy Rainey aussi. Malheureusement tous les gens que j’aimais bien ont eu la bêtise de mourir : Hampton Hawes par exemple… J’aurais dû leur expliquer comment il fallait faire pour durer.
Franck Bergerot : Après votre dernier concert à Gaveau, vous aviez confié être déçu…
Souvent, quand je joue, je ne suis pas content, et en me réécoutant je me rends compte qu’il y avait quelque chose de nouveau, dans l’harmonie ou l’improvisation. Dans le disque, comme je le dis à la fin du texte au verso, je pense qu’il y avait quelque chose en gestation que j’aurais aimé continuer, que d’autres feraient, mais c’est une voie que personne n’a envie de suivre. Mais à l’époque, je ne savais pas que ce serait mon dernier concert.
Fred Goaty : J’ai l’impression que vous n’avez pas de regrets concernant votre carrière…
Le nombre de choses que je regrette de ne pas avoir faites est énorme ! J’étais trop timide pendant des années, c’était terrible ! J’ai écrit trois musiques de films pour Jean-Paul Belmondo, j’aurais pu au moins avoir le réflexe de lui faire savoir que je voulais le remercier, et surtout lui écrire cinquante autres musiques de film ! Je ne l’avais pas rencontré, j’étais trop discret, pas le genre à aller frapper aux portes. Mais je ne peux pas regretter d’être comme je suis. Ce que j’aimerais avoir, c’est cinquante ans de moins.
Repères
1927 Naissance, le 27 août, à Alger.
1945 Il devient musicien professionnel.
1952 Il commence à jouer au Club Saint-Germain.
1953 Enregistre avec Django Reinhardt.
1956 Enregistre “Son piano son trio” pour Vogue sous le nom de Jo Jaguar. Création de son premier big band.
1958 Compose sa Suite en ré bémol pour quartette de jazz.
1959 Signe la musique du film de Jean-Pierre Melville, Deux hommes à Manhattan.
1960 Jean-Luc Godard fait appel à lui pour celle d’À bout de souffle.
1963 Sortie de “At Newport ’63” (RCA Victor), avec Teddy Kotick à la contrebasse et Paul Motian à la batterie.
1964 Rencontre Thelonious Monk à San Francisco.
1969 Enregistre “Impressive Rome” (Campi Records) en quartette avec Lee Konitz.
1970 “Sans tambour ni trompette” (RCA Victor), avec Gilbert Rovère et Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse.
1973 Sortie de “Key For Two” (BYG Records), avec Hampton Hawes.
2000 Les Acteurs de Bertrand Blier est sa dernière musique de film en date
2005 Parution de Martial Solal, compositeur de l’instant, entretien avec Xavier Prévost (éd. Michel de Maule).
2018 “Prix Jeune Talent” (!) de l’Académie du Jazz.
2024 Il tire sa révérence le 12 décembre, entouré des siens, à Chatou.
Au début des années 1980, Serge Gainsbourg avait fait une demande inattendue à Martial Solal… Le pianiste se souvient, au moment où la Maison Gainsbourg ouvrira ses portes le mercredi 20 septembre et où l’on y découvrira notamment des cassettes très, très rares…
« Gainsbourg descendait quelquefois au Club St-Germain, et j’ai en mémoire sa présence derrière moi pendant que j’y jouais. Il aimait beaucoup le piano, le jazz ; il n’était pas encore une star à cette époque, mais il commençait à être connu. Mon véritable souvenir de Serge Gainsbourg est plus personnel : il y a quelques années, au début des années 1980 je crois, il a demandé par l’intermédiaire de mon agent de l’époque de lui donner un concert privé pour essayer chez lui, rue de Verneuil, un piano droit Yamaha mécanique qui reproduisait très fidèlement, après enregistrement sur une cassette, la musique jouée avec tous les mouvements effectués sur le piano. Il tenait à me payer comme pour un concert. J’ai accepté, l’histoire m’amusait. C’était très étrange et très sympathique à la fois : Serge et sa nouvelle femme [Bambou, NDR] étaient assis tout près du piano pendant que je jouais, immobiles et silencieux pendant deux heures. Je ne me souviens pas de ce que j’ai joué, mais probablement quelques standards qu’il connaissait. Ce piano était très lourd, à la limite du jouable, j’ai fait ce que j’ai pu. Il m’a ensuite fait visiter sa belle maison, rangée avec un ordre immuable, m’a t-il dit. Puis nous avons dîné ensemble dans un restaurant où il avait ses habitudes. Une très étonnante aventure dont j’ai gardé un bon souvenir. Quelque temps après, j’ai lu dans une interview de Gainsbourg qu’il se vantait de posséder la “cassette la plus chère du monde”. Et c’était probablement vrai… » Au micro : Franck Bergerot
Postlude : Ces cassettes sont en réalité au nombre de trois et exposées à la Maison Gainsbourg, située au 14, rue de Verneuil, Paris 7ème.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les amours jazz de Serge Gainsbourg, et bien plus encore dans notre numéro spécial !
