Coups de cœur à Malguénac
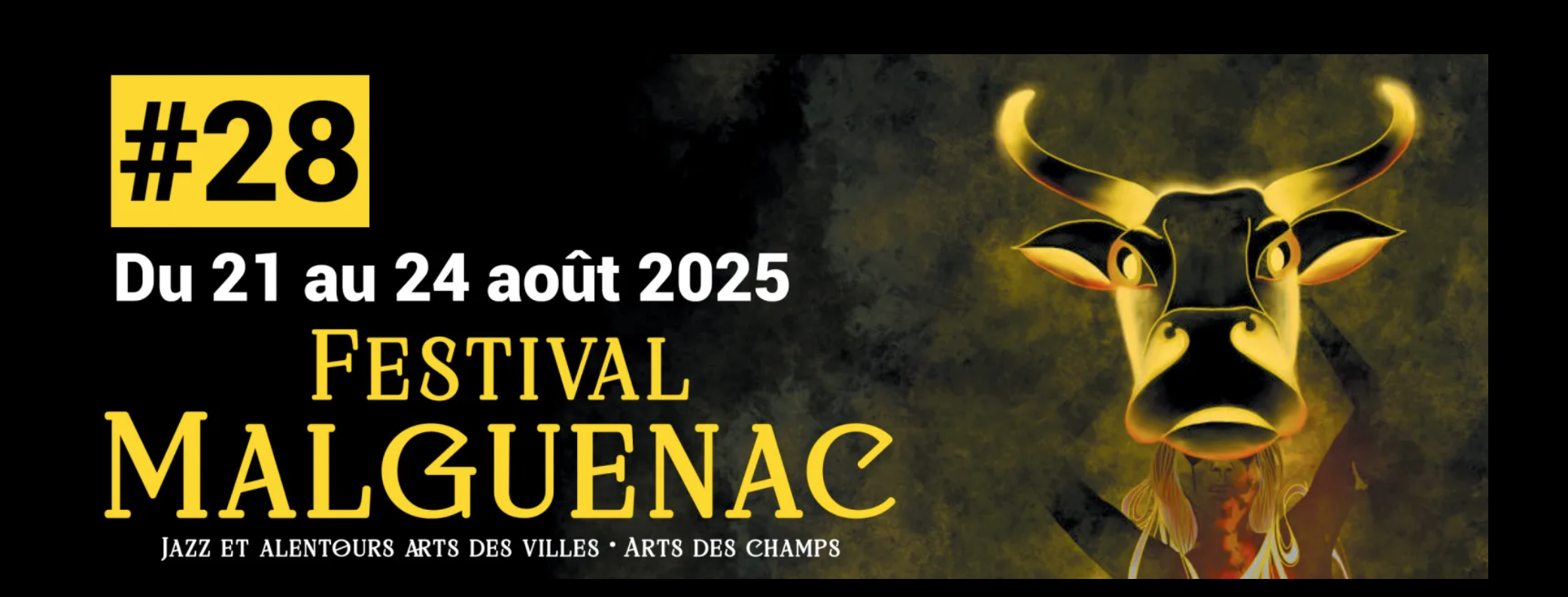
Mon cardiologue ne m’a autorisé pas plus d’un coup de cœur par soir. Le festival de Malguénac se déroulant sur trois jours… je me suis tout de même autorisé un excès. Le 21 août : Christie Dashiel. Le 22 août : Joe Sanders… et Band of Dogs. Le 23 : Dick Annegarn.
Le 21 août : Christie Dashiel. Répertoire original, musicalité, jouage avec sa rythmique pourtant d’emprunt (admirables Tony Tixier, Reggie Washington, Yoran Vroom), scatteuse improvisant pour de vrai, souplesse virtuose au naturel sans aucune esbroufe, fraîcheur et métier, simplicité scénique. Le jazz vocal peut être aussi “Le Jazz”. Et ce tendre et bouleversant rappel pour saluer ses frères là-bas, aux États-Unis de Donald Trump. Je songeai en frissonnant de tristesse et de rage aux propos récents de ce gigantissime crétin criminel que les USA se sont donnés pour président, à propos du Smithonian, cette mémoire de l’Amérique noire qu’il voudrait blanchir de toute référence à l’esclavage, à la ségrégation, aux crimes du Ku Klux Klan, à la participation de régiments noirs aux deux conflits mondiaux, à la répression des mouvements de protestation pour les droites civiques, etc., nous rappelant du même coup que cette douloureuse histoire est loin d’être close.
Partagé mon dîner debout avec Mike Ladd devant un bidon renversé – nous n’avions jamais échangé qu’une boutade à la sortie de son magnifique concert à en duo avec Mathieu Sourisseau au BMC Jazz Club de Budapest il y quelques mois. Ce 21 au soir, sur le Campus du festival toujours magnifiquement habité et décoré, il laissait vagabonder sa curiosité gustative vers les stands de restauration plutôt que de profiter du repas réservé aux artistes. Mordant dans sa galette, il m’évoquait avec des embruns dans le regard son séjour à l’extrême pointe du Finistère lorsqu’il arriva de New York en France. Sur la scène de Malguénac, il était attendu le lendemain soir sein du Band of Dogs de Jean-Philippe Morel et Philippe Gleizes.
Le 22 août : Joe Sanders Quartet. Ravissement d’emblée, pour ce son quasi acoustique, au profit d’une musicalité tendre et puissante, dynamique au sens de respect des nuances du pianissimo au fortissimo. Joe Sanders commence par faire chuchoter sa contrebasse, fredonnant dans un relatif unisson, évoquant l’art de la berceuse, l’Afrique et ses cordophones qui me reviendront souvent à l’esprit au cours du concert. Entre la batterie de Gregory Hutchison, nuancée jusqu’à quelque fracas de tonnerre, active dans l’expression du time qui peut bouger à l’amble de la contrebasse, mobile dans le déplacement constant de la battue d’un fût, d’une cymbale à l’autre, avec ici et là quelque coup orphelin qui semble tomber d’une autre planète, batterie et contrebasse marchant main dans la main sur des tempos dont la découpe peut opérer une mue par quelque équivalence qui étourdit l’auditeur hésitant un instant entre deux battues.
Face à eux Logan Richardson (sax alto droit et soprano), Jure Pukl (sax ténor) préfèrent le partenariat à l’affrontement (dans un papier d’annonce, j’évoquais la culture de la joute et du cutting contest), se passant le relai sans crier gare, partageant une sorte d’intelligence musicale commune ; le ténor de Pukl un peu mat se faisant parfois “honky-bluesy”, Richardson commençant parfois ses solos par cette espèce de note à note prévenant tout cliché que nous aimions chez Lee Konitz pour prolonger cette lucidité vers des zones colemaniennes (à la Ornette, voire à la Steve). Il y aura un thème très ornettien, un franc gospel… nous rappelant dans un cas comme dans l’autre que cette musique est d’essence mingusienne. Joe Sanders est un séducteur, qui pose sa contrebasse – on se dit un moment qu’il va quitter la scène, que le concert termine – et s’avance tranquillement, badin, gamin, faussement timide, minaudant un instant comme s’il n’osait parler, et s’adressant finalement au public en français (presque sans accent) et en anglais, un peu comme dans une conversation particulière en tête à tête, à mi-voix, prenant son temps pour trouver ses mots, avec un séduisant mélange de malice et de tendresse. Rappel, avec le Hey Joe de Jimi Hendrix jeté à la tête du public comme un bouquet avec toute son eau.
Un seul coup de cœur par soir, m’avait dit mon cardiologue. J’ai outrepassé sa recommandation. À l’exception de Mike Ladd (slam), pour lequel j’ai vraiment pris le train en marche, les Dogs du Band of Dogs Septet, je les ai tous vus sinon naître, du moins grandis comme de jeunes chiots, entre 1990 et 2020. Et j’ai suivi avec plus ou moins d’assiduité, plus ou moins d’enthousiasme, la carrière du noyau dur de cette “bande de chiens” : soit Jean-Philippe Morel (basse électrique) et Philippe Gleizes (batterie), que j’ai souvent trouvés trop bruyants à mon goût, prêchant moi-même toujours plus dans le désert pour une écologie du son, non pas strictement acoustique, mais un certain rapport au volume sonore qui, outre à nos tympans, nuit à la proximité de la musique et relève d’une certaine conception du pouvoir.
Ces deux-là auront été des fidèles de Malguénac, à moins que ce soit Malguénac qui leur soit fidèle, puisque toutes les formules de ce tandem s’y sont trouvées programmées, avec ce septette complété par Claudia Solal (voix), Clément Janinet (violon), Hugues Mayot (sax ténor), Emmanuel Borghi (claviers) et, susnommé, Mike Ladd. D’abord les oreilles protégées par deux “capotes auditives” sur les recommandations de mon ORL, j’ai fini par prendre le risque de m’en débarrasser pour préciser un peu le spectre sonore, frustré cependant par cet espèce d’aplat que donne ce genre de sonorisation, devinant la qualité des textures sonores et la dynamique entre fortissimo et ce qui aurait dû être des pianissimo au gré de grandioses arches dramatiques et soniques dont témoigne leur disque “#3” avec un personnel toutefois en partie différent. Perdue dans ce paysage musical – mais ça peut être un choix esthétique, mais il y faudrait une sonorisation plus détaillée –, Claudia Solal connaît également de formidables échanges avec le flow inexorable autant que d’une grande flexibilité de Mike Ladd. Clément Janinet, Hugue Mayot et Emmanuel Borghi se voient octroyer de grands solos dont ils savent habiter pleinement l’étirement. Quant au tandem des deux co-leaders, ils sont le cœur battant de ce projet monumental.
23 août : après une ouverture flamboyante des fortes en gueule de Kaolila que j’ai déjà saluées en d’autres pages en compte rendu de Malguénac il y a deux ans et pour annoncer l’édition 2025, il y a une semaine, voici Dick Annegarn. Le public est venu pour lui. Je me souviens de l’un de ses premiers concerts, en banlieue Ouest de Paris, vers 1973. Ce post-adolescent embarrassé de lui-même qui semblait coiffé d’une touffe de paille, et chantait comme ça lui venait des textes qu’on n’imaginerait pas autrement, d’une voix incertaine et pourtant placée. Il projetait le son de sa guitare folk avec la même franchise faussement gauche, d’un finger picking personnel acquis visiblement à l’écoute des grands bluesmen du Mississippi à la Côte Est, des guitaristes de ragtime et ceux du folk revival britannique des années 1960.
Le public de Malguénac semblait venu spécialement pour lui, pour ses premières chansons… Sacré Géranium, Bébé Éléphant, etc. Il joue de cette attente, promet, cite le temps de le faire participer, lui proposant quelque jeu musical, toujours un peu farceur ; il est debout devant le micro avec ou sans guitare qu’il abandonne sur une table pour se saisir de petits harmonicas ou d’une flûte (il est entré en jouant de la flûte, comme le preneur de rats). Il mange les mots, brouille les hauteurs de notes… c’est encore un jeu, comme une sorte de cache-cache du texte et de la mélodie avec le public et avec lui-même. Lorsque soudain il chante vraiment, sa voix est admirablement placée, articulée… Il fredonne entre les paroles et signale en passant : « Ça, normalement, c’est joué par mon big band. » Il parle du jazz qu’il aime, cite des noms, Monk, Duke, Bird… puis se met à chanter un truc sans queue ni tête – ne nous laissant en tout cas pas le temps de distinguer l’une de l’autre – avec des harmonies qu’il savonne sur l’air de Crepuscule with Nellie. Et c’est beau comme du Monk, sauf que c’est du Dick Annegarn. Ce grand Duduche, ce grand dadais qu’il est si peu tant il maitrise ses effets, chahutant gentiment son auditoire, voire la sono pour un excès de réverb… reste d’une élégance et d’une belle tendresse au milieu des fleurs en pots que le public a été invité à déposer sur le devant de la scène avant le concert. Ah, c’qu’on est bien dans ce jardin, loin des engins, par besoin besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être saoul…
Passer de ce naturel à la grand prêtresse du vaudou haïtien Moonlight Benjamin est d’autant plus difficile que l’on passe du jardin aux engins, d’une sono démentielle, la voix indistincte (avec ou sans bouchons, mais mieux vaut les garder) mangée par les deux guitares, la basse et la batterie. Je suis rentré chez moi en voiture en écoutant le disque avec les mêmes. C’était finalement beaucoup mieux, encore que le mix des guitares, par ailleurs superbement incisives dans leurs riffs et leur son, m’ait paru encore disproportionné par rapport à la voix. Franck Bergerot