Very Sad-Lee (Hommage à Lee Konitz)
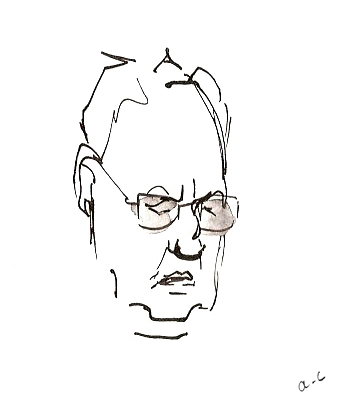

Lee Konitz (sax alto), Thomas Ruckert (piano), George Schuller (dm), jermey Stratton (contrebasse) , 18 et 19 novembre 2014, le Sunset 75001 Paris

Le vieux monsieur arrive cinq minutes avant les autres musiciens et fait le pitre. Il met la main en visière devant ses yeux comme s’il les voyait arriver de très loin, fait semblant de les siffler. Les musiciens arrivent. Le patron du Sunset aussi. Il se lance dans une présentation de l’artiste. Celui-ci fait mine de bailler : « Wake me up when you finish ». Puis il met les choses au point sur la prononciation : « My name is not Ko-ni-tze », my name is « Ko-nitz » dit-il en appuyant sur la première syllabe. Lee Konitz, est un gamin mal élevé de 87 ans. Il est assis, son saxophone alto sur les genoux, avec ses lunettes fumées qui cachent ses yeux. Il semble se demande quelle blague il pourrait bien faire. Bon, mais il faut quand même jouer. Les gens sont venus pour ça. « Nous allons vous jouer… » (il chante les première mesures de Stella by starlight) . La salle reprend la suite. « Bien et maintenant , le morceau suivant… ».

Finalement il prend son sax, et donne une belle version de ce standard qu’il laboure depuis plus de 60 ans. En l’écoutant, on songe à sa théorie de l’improvisation en dix cycles, de la paraphrase à la création d’une mélodie entièrement nouvelle, où chaque chorus est une manière de creuser plus profondément. Mais ici il ne prend que deux ou trois chorus : à quelle stade du cycle en est-il ? Peu importe, il y a à la fin de son improvisation des phrases de pure poésie qui voltigent dans l’air et semblent hésiter à se poser. Il termine sur une note aiguë qu’il arrive à tenir, mais en posant son sax il souffle ostensiblement, comme quelqu’un qui aurait gravi un interminable escalier. Il joue ensuite, magnifiquement, How deep the ocean, en transformant le thème, en le remodelant, en le réinventant réellement.
A la fin de son deuxième ou troisième chorus il scatte (c’est un scat délicat, où reviennent les syllabes di-da-da). Il procèdera ainsi toute la soirée. Car le vieux monsieur, toujours bon pied bon œil, se ménage parfois. Il s’attarde désormais beaucoup dans les graves (comme le relevait Thierry Quenum dans sa chronique du premier concert) et l’on ne retrouve que par instants ce son d’acier glacé caractéristique de ses albums des années cinquante ou soixante. Mais de sa difficulté à sortir désormais des aigus tranchants comme une lame, il tire une sorte de nouvelle expressivité. Il joue beaucoup plus sur le fil de l’émotion avec ce son rugueux, instable, qui bouge, vibre, craque, tremble. L’émotion est encore plus directe.
Le vieux monsieur aime titiller ses musiciens. Il demande à son contrebassiste ce qu’il voudrait jouer. Embarras de celui-ci (« I didn’t want to,put pressure on you » rigole Konitz) qui finit par proposer une introduction qui mène tout droit à Body and Soul. Là-dessus, Konitz est à son affaire. Il improvise directement sans passer par la mélodie initiale.

Il finit son chorus en chantant. Le pianiste Thomas Rückert l’accompagne avec un toucher d’une délicatesse infinie. Konitz le fait applaudir : « Ce gars-là jouait Bach à Londres la semaine dernière » (évidemment, Thomas Ruckert épicera son chorus suivant de petites pincées de Bach).

Le morceau suivant, c’est Four. D’habitude le thème est prétexte à lâcher les chevaux. Mais Lee Konitz l’aborde tout en douceur. C’est un tout petit filet de souffle qui sort de son saxophone. C’est déjà le dernier morceau. Konitz demande à la salle de lui suggérer un titre. Un gars propose « I hear a rhapsody ». Lee Konitz réfléchit une demi-seconde, on imagine que la grille passe à toute allure dans son cerveau, et il aquiesce. C’est un morceau qu’il connaît bien, dont il donné une version sublime dans son duo avec Michel Petrucciani. Il se tourne vers son pianiste et ne peut s’empêcher de faire une petite blague : « I hear a rhapsody…..and not I hear a Rap-CD ». Ensuite il joue. Le petit filet de son qu’il avait sur Four a pris de la consistance et de l’ampleur. Il expose le thème d’une manière prenante, en donnant à chaque note leur poids d’émotion. C’est la fin d’un premier set un peu court mais traversé de moments sublimes. L’estrade du Sunset est un peu haute. Le vieux monsieur s’en sort quand même. Il a même le toupet de proposer sa main au pianiste, comme s’il voulait l’aider, lorsque celui-ci en descend à son tour. Il se dirige vers le bar, accessible, accueillant à tous ceux qui veulent lui parler, mais toujours avec dans l’œil cette lueur ironique, mordante. La dessinatrice et plasticienne Annie-Claire Alvoët (qui illustre cette page) passe à côté de lui et lui montre les cinq ou six dessins qu’elle vient de réaliser, en lui demandant d’en choisir un. Il regarde avec intérêt. Mais il se trouve trop gros, trop vieux. « It’s not fun getting old… ». Il remarque : « Vous n’auriez pas dû dessiner le corps ni les clés du saxophone. Pour moi, il est transparent ; ce que j’entends dans ma tête sort directement du pavillon ». Il se regarde et grimace : « faîtes-moi plus maigre, avec des joues moins grosses ! ». Il roule le dessin, et l’emporte sur scène (il le mettra dans le piano et n’oubliera pas de le reprendre après le concert).
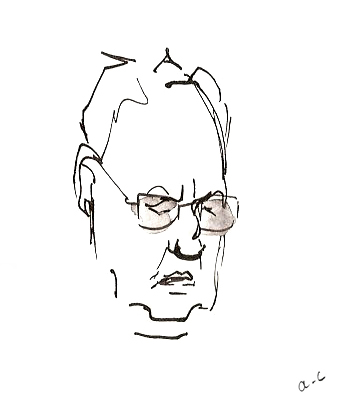
Le deuxième set commence sous des auspices encore meilleurs. Lee Konitz encore en avance, fait encore semblant de voir les musiciens arriver de loin, en se servant du dessin comme d’une longue vue. Puis, il prend son sax d’un air plus décidé, souffle très fort : « C’est comme ça que j’entends le son du saxophone : fort, et nerveux ! ». C’est avec ce son retrouvé qu’il joue un somptueux What’s new. Les doigts de Thomas Ruckert touchent à peine le piano. Le batteur George Schuller caresse la cymbale avec légèreté.

Konitz complète son chorus en scattant, et grommelle comme pour lui-même : « Je me demande si je ne vais pas finir par devenir un genre de type à la franck Sinatra… ». Après quoi le quartet joue I’ll remember April et thingin. Même s’il y a deux faux départs sur ce dernier morceau (pourtant une de ses compositions, démarcation de all the things you are) Konitz joue avec plus de flamme que dans le premier set. Parfois, cependant, il regarde son bec de saxophone d’un air dubitatif, et se touche la lèvre supérieure avec une légère inquiétude. Il écoute ses partenaires en dodelinant la tête, souvent en fermant les yeux, avec une majesté d’empereur romain. A la fin du morceau, le pianiste s’adresse à lui avec une courtoisie d’un autre temps : « May I start something? -Please do» répond Konitz, royal. Il introduit darn that dream, une des ballades préférées du maître.

Le chorus de Lee Konitz, est sublime, et celui du pianiste atteint presque au même degré de lyrisme. Konitz se tourne de nouveau vers ses musiciens : « Que veulent jouer ces jeunes gens ? ». Le contrebassiste propose Cherokee. Konitz fait la moue. « But not too fast ! ». A la fin de ce second set, riche en moments formidables, il demande encore au public de proposer un morceau. Un type (je crois bien que c’est moi, mais il faudrait vérifier auprès des intéressés) risque timidement : You don’t know what love is. Une petite lueur s’allume dans les yeux de Konitz. « OK ». Il expose le thème, lentement, majestueusement, gravement, désireux de n’oublier aucune nuance. Comme dans I hear a thapsody au premier set, les notes prennent un poids et une vibration incroyable. Il semble avoir tout dit simplement en exposant le thème. Son bref chorus, ensuite, est lyrique, intense, avec quelques phrases sublimes que j’essaie de retenir mais qui me filent entre les mains comme du sable. C’est fini. Il présente ses musiciens (feint de ne plus se souvenir du nom du batteur George Schuller, qu’il appelle George Washington junior avec une ironie pleine de sel: George Schuller n’est pas le fils de George Washington mais du compositeur Gunther Schuller…). Puis il tend la main au pianiste et lui murmure à l’oreille « Thank You !You played beautifully ! ».
Ensuite, c’est la foule habituelle des solliciteurs de tout poil. Un italien au regard implorant, venu avec son fils, un adolescent dégingandé resté à l’écart, veut lui demander quelques mots sur Gil Evans. Il lui met devant le nez un enregistreur. Mais Konitz, en rangeant son sax dans son étui, bougonne : « On ne se connaissait pas si bien ». L’italien, un peu maladroit : « Vous ne vous souvenez pas du disque que vous avez fait avec lui ? « Konitz, un peu sec : « je me souviens de tous les disques que j’ai faits ! ». Il délaisse le père pour aller trouver le fils, grand adolescent, un peu à l’écart, qui n’en mène pas large, et qui joue du saxophone. Il discute gentiment avec lui quelques minutes et lui dédicace un 33 tours de « Birth of the cool ».
Après avoir un peu hésité (et si c’était moins bien ?), je décide de revenir pour le deuxième set du concert du lendemain. Il sera équivalent au concert de la veille, avec des moments magiques sur à peu près les mêmes thèmes : How deep the ocean, thingin, Solar , darn that dream. Lee Konitz joue aussi 317 East, 32nd street, un morceau de son maître Lennie Tristano, démarcation Out of nowhere. Il précise, affable et pédagogique : « Je vais jouer la mélodie initiale puis la mélodie de lennie Tristano, OK with that ? ». Il chante, comme la veille, une partie de son chorus. Le dernier morceau est You don’t know what love is. Comme la veille il y a ces moments où les notes semblent se gorger d’une force, d’une densité inouïe. Et tous ces moments, où après son propre chorus, il reprend le sax pour poser quelques notes, au gré de son humeur, sur ce que le contrebassiste ou le pianiste viennent de jouer. Ce n’est pas vraiment un nouveau chorus, pas vraiment un contrepoint, c’est autre chose, c’est de la pure liberté. La dessinatrice Annie-Claire Alvoët est revenue elle aussi le deuxième soir. Lee Konitz n’ayant pas apprécié de se voir vieux et joufflu, elle lui remet deux dessins où elle a malicieusement gommé le poids des ans. Sur l’un des dessins, un Lee Konitz à peine sorti du berceau (mais avec son saxophone et déjà toute sa malice)

Voilà Lee Konitz qui éclate de rire, et qui, ravi, roule le dessin et le range dans son étui à saxophone. Un peu plus tard, à la dessinatrice qui lui dit « Have a good night » en quittant le sunset, il répond « have a good life ».

On sort du concert avec un sentiment d’infinie gratitude envers ce musicien. Dans un documentaire de Robert Daudelin de 1987 on voit Lee Konitz, 60 ans à l’époque, rendre hommage à Benny Carter, dont il dit qu’il fut une de ses premières influences. Il ajoute ceci : « Il vient de célébrer ses 79 ans, et il est toujours une de mes inspirations, en particulier pour avoir survécu avec autant de grâce » (in such a graceful way). Trente ans plus tard, c’est exactement ce qu’on aurait envie de lui dire.
Texte JF Mondot
Dessins AC Alvoët