À l’affiche du 16 mars : The Trio et Martial Solal sans tambour ni trompette
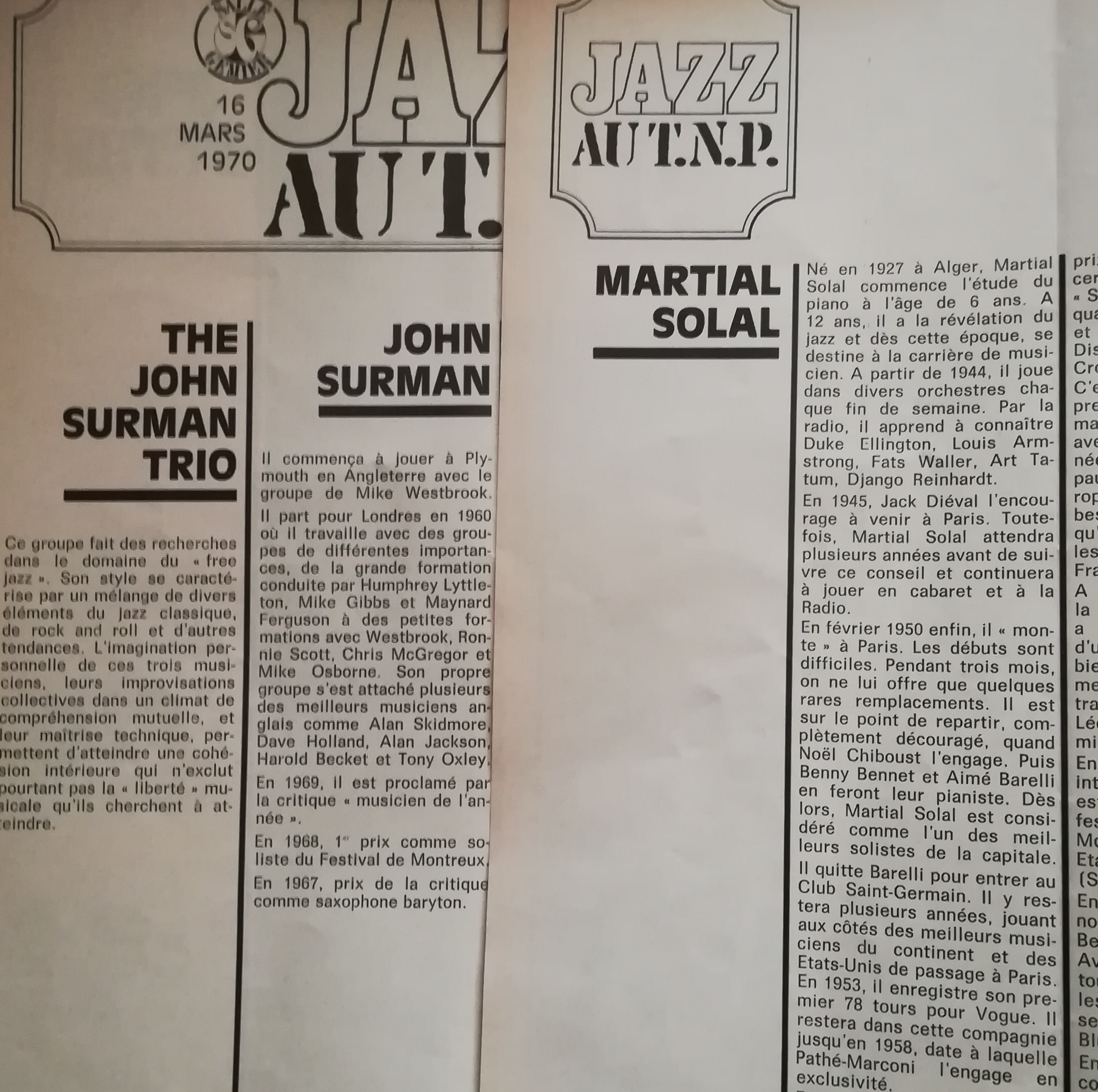
Coronavirus oblige, voici ces pages réduites au silence qui a gagné les salles de concert. Mais un 15 mars sans concert, c’est trop triste. Remontons dans le temps jusqu’au 16 mars 1970. Ce soir- là, sur la scène de la Salle Gémier à Paris, dans le cadre de “Jazz au TNP,” se succédaient The Trio – John Surman, Barre Phillips, Stu Martin – et le trio de Martial Solal à deux contrebasses (avec Guy Pedersen et Gilbert Rovère).
C’est un souvenir personnel, mon premier concert de jazz. Pas exactement, car également au TNP, mais dans la grande salle du Palais de Chaillot, quelques mois plus tôt, le 29 octobre 1969 (j’avais 16 ans), j’étais allé voir le Clarke-Boland Big Band (entendez du batteur Kenny Clarke et du pianiste et arrangeur Francy Boland). La musique pour big band ne m’était pas totalement étrangère. Parmi les trois 25 cm de jazz figurant dans la discothèque de mes parents (tous trois de la collection Jazz pour Tous dirigée par Boris Vian chez Philips), il y avait le “Newport 1958” de Duke Ellington que je connaissais par cœur. Jimmy Woode y tenait d’ailleurs la contrebasse, comme ce soir de 1969 sur la scène de Chaillot. Le nom de Kenny Clarke ne m’était pas non plus inconnu, pour la seule et unique raison qu’il donnait des cours de batterie au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye fréquenté par quelques copains du lycée Marcel Roby, mais j’étais un peu troublé par la présence dans ce Clarke-Boland Big Band d’un second batteur, quasi homonyme, Kenny Clare.
Mes souvenirs sont assez flous. Sur la scène où, quelques années plus tôt, mes parents m’avaient emmené voir Jean Vilar jouer L’Avare dont je gardais un souvenir en revanche assez net, les musiciens, bien rangés comme des pions derrière leurs pupitres, m’avaient paru si loin vus du haut et du fond de la grande salle où j’avais trouvé une place accessible à ma bourse, parmi un public de jeunes gens beaucoup plus âgés que moi (taille, système pileux, voix totalement muée, propos assuré et connaissance du jazz assumée, un look d’ailleurs pas très conforme à l’idée que je me faisais de la jeunesse parisienne soixante-huitarde). Je me souviens cependant, bien qu’ayant toujours eu une orthographe très impressionniste, que l’un des trombonistes avait un nom du Nord : Åke Persson, avec ces deux ss après une consonne et cette petite bulle au-dessus du A, qui ne figurait d’ailleurs peut-être pas dans les programmes imprimés de l’époque et que j’apprendrais à placer beaucoup plus tard à l’âge du traitement de texte. Phil Woods, dont je ne savais rien de l’European Rhythm Machine qu’il partageait alors avec George Gruntz, Henri Texier et Daniel Humair, m’avait impressionné et son nom m’était resté pour plus tard. Et peut-être plus encore celui de Johnny Griffin, qu’un ami – le seul dans mon entourage à acheter des disques de jazz –, m’avait fait écouter sur le disque “Full House” de Wes Montgomery. Il nous avait offert un solo d’un genre homérique que j’apprendrais plus tard à qualifier de “stop chorus” (lorsque le soliste fait signe à la rythmique de se taire pour le laisser seul le temps d’un ou plusieurs chorus). Le reste de mes souvenirs, je les dois à la publication en 2001 de ce concert sur deux CD de marque Delta Music estampillés Europe 1. J’y découvrirais que figuraient ce soir-là aussi des figures comme Benny Bailey, Art Farmer, Idress Sulieman, Sahib Shihab, Ronnie Scott ou Tony Coe dont les noms entrèrent dans mon vocabulaire beaucoup plus tard.
Dans la pile de Bref, la revue du TNP, que mes parents laissaient s’accumuler dans les toilettes, j’avais ainsi pris l’habitude de repérer les soirées musicales du Théâtre national populaire. Mes premières expéditions nocturnes vers Paris – dont j’apprendrais plus tard que le même voyage dans l’autre sens Paris-banlieue relevait, même du temps du RER, de la mission impossible pour mes amis parisiens toujours prompts à sauter dans le Paris-Vintimille ou un vol pour l’outre-mer – avaient été dédiées aux Journées de musique contemporaine organisée conjointement par le TNP et l’ORTF à l’automne 1969, au cours desquelles assis à côté de l’un des haut-parleurs sphériques disséminés dans la salle je m’étais familiarisé avec les étrangères spectres sonores inventés dans les laboratoires du GRM (Groupe de recherche musicale). Dans le numéro 130 de Bref (février 1970), je découvris la photo d’un personnage qui me parut singulièrement sympathique avec son saxophone baryton posée sur son pantalon à carreau : John Surman. J’aimais déjà beaucoup le baryton, à cause de la merveilleuse conversation entre Harry Carney et Gerry Mulligan sur Prima Bara Dubla (Duke Ellington “Newport 1958”) qui avait quelque chose de l’intarisable polémique de personnages de Pagnol sur une terrasse de café de la Cannebière. Et puis, ce John Surman était entouré de musiciens – Barre Phillips et Stu Martin – qui me semblaient plus proches que les musiciens de Francy Boland et leurs fans. Ils auraient pu être de grands frères, quoiqu’ils aient eu de 9 à 19 ans de plus que moi ! Ou alors de sympathiques oncles, un peu plus jeunes ou plus bohèmes que les miens. Et cette familiarité compta plus à mes yeux que leurs curriculum vitae respectifs (Mike Wesbrook, Chris McGregor, Mike Osborne, Dave Holland pour Surman ; le New York Symphonic Orchestra, Archie Shepp et George Russell pour Barre Phillips ; Quincy Jones, Gary Burton, Lee Konitz, Attila Zoller et les frères Kühn pour Stu Martin).
La salle Gémier où ils se produisaient ce 16 mars 1970 était à taille humaine et ils entrèrent avec la bonhommie de joueurs de pétanque surpris de découvrir des spectateurs les attendant pour les voir jouer sous les platanes. Ils se saisirent de leurs instruments avec cette apparente désinvolture qui m’en fit des amis, Barre Phillips surtout, dès les premières notes, faisant de sa contrebasse, non pas la fière grand-mère, garante de la dignité de l’orchestre, mais une jeune femme gracile, espiègle, parlant à ma jeune libido musicale. La musique… J’en ai gardé le souvenir précis grâce au disque du trio, double album blanc – contemporain d’un autre plus célèbre – se distinguant par cette seule mention “The Trio”. Il y eut d’héroïques chevauchées de tempo où Surman réinventait l’improvisation coltranienne avec un lyrisme nouveau de l’extrême grave à l’extrême aigu de son baryton (Oh Dear, Caractacus) ; une sorte de jazz de chambre rappelant que Barre Phillips était passé par la musique de Jimmy Giuffre, ce que je n’apprendrais que plus tard, considérant, contre toute réalité chronologique, la musique du premier comme l’aboutissement de la seconde, voire comme son légitime original (Dousing Rod) ; des lignes mélodiques d’une tendresse folle (les premières notes de Silver Cloud dont je retrouverais la continuation dans l’album solo « Journal Violone », à l’époque déjà gravé) ; des grands épanchements du baryton aux apparences de vieux airs irlandais (Incantation) ; des ostinatos de basse ensorcelants ; des effondrements de tambours aux peaux tendues très hautes sous les baguettes de Stu Martin sous-entendant ou dynamitant les up tempos, mijotant ailleurs de délicats rubatos. Sur Let’s Stand l’archet de Phillips entrainait la clarinette basse de Surman sur des sonorités de glass harmonica. Qu’une contrebasse puisse ainsi sonner, ou simplement comme un violoncelle, fut une révélation, notamment dans le merveilleux pas de deux contrebasse-baryton Porte des Lilas ou le bal des feux follets conduit par le trio sur Sixes and Sevens. Un monde en suspension entre l’âme britannique de Surman, les restes du rêve californien de Phillips venu s’installer en Europe et les leçons instrumentales prises auprès du grand Fred Zimmermann, gourou de la contrebasse classique, et l’énergie new-yorkaise de Stu Martin également exilé, un pont jeté entre la légitimité du jazz américain et les hérésies qu’il inspirait alors partout en Europe.
Après un tel rêve éveillé, l’entrée de Martial Solal, dont alors je ne savais rien, jeta un froid. Une autre génération, un autre état d’esprit, une musique d’une rigueur millimétrée qui m’intimida, puis m’intrigua, pour enfin me pénétrer durablement à dessein d’un lent mûrissement. L’année suivante, au sortir d’un hôpital quitté en chaise roulante après un long séjour à l’horizontal consécutif à un rude accident dont les séquelles m’interdisaient l’usage des béquilles, mes amis de lycée m’attendaient avec une pile de disques en guise de cadeau de retour à l’air libre (on n’utilisait pas à l’époque le mot de déconfinement) : s’y trouvaient notamment “The Trio” et l’album de Martial Solal “Sans Tambours ni trompettes”. L’un et l’autre, c’était comme si je les connaissais déjà, mais pas exactement l’un comme l’autre. Ainsi nommé parce que son trio était constitué de deux contrebassistes (Guy Pedersen et Gilbert Rovère au concert, Gilbert Rovère et Jean-François Jenny-Clark sur le disque), l’album de Solal constituait un labyrinthe offrant mille recoins à découvrir et redécouvrir. Et si j’avais aimé la (fausse ?) désinvolture de The Trio, il y en avait là une autre, d’une autre espèce, peut-être plus espiègle, pince sans-rire, irriguant la musique même de Solal, comme pour excuser la technique pianistique époustouflante et l’ambition formelle de ce concerto pour piano et tandem de contrebasses, le tout dissimulant un sens poétique que les écoutes répétées faisaient sourdre de cette matière tout à la fois aride et pleine de surprises, voire de sourires. Et si les membres du Trio furent mes premiers héros en jazz, j’accordai tout au long des années 70 une large part de mes sorties parisiennes, toujours plus nombreuses, aux concerts de Martial Solal dont “Sans Tambours ni trompettes” m’avait enseigné qu’il était l’une des voix importantes du jazz contemporain. Au détriment d’ailleurs de certains fondamentaux de la scène jazzistique qui auront rendu mon parcours professionnel quelque peu atypique, si ce n’est aberrant.
Il y eut un autre 16 mars, celui de l’année 1976 au Studio 104 de la Maison de la Radio. Première partie, the Trio, alors sur sa fin, John Surman ayant pris un tournant amorcé en 1972 avec le “one man show” de “Westering Home” qui trouverait son aboutissement sept ans plus tard chez ECM avec “Upon Reflection”. Ce concert de 1976 voyait Surman et Stu Martin ajouter le synthétiseur à leur panoplie instrumentale, ce qu’ils firent le même mois à Ludwigsburg lors de l’enregistrement de “Mountainscapes” de Barre Phillips, chez ECM, concert et album n’ayant laissé nulle trace ni dans ma mémoire ni dans ma discothèque où le second figura pourtant quelques temps. C’est dommage, j’aurais bien profité de cet épisode de confinement pour le réécouter.
Deuxième partie, Lee Konitz (sax alto, on s’en doute), Martial Solal (piano, évidemment), Peter Ind (contrebasse) et Al Levitt (batterie). On redécouvrait alors Lee Konitz, on en parlait. Anthony Braxton, dont je fréquentais alors beaucoup les concerts, en chantait les louanges. Nos journaux spécialisés en vantaient les derniers enregistrements publiés par SteepleChase (quartette funambule avec Martial Solal, NHOP et Daniel Humair “live” à Antives, duo avec Red Mitchell dont l’optimisme me sauva des heures de détresse d’une post-adolescence pathétique, solo hallucinant avec un standard par face du vinyle “Lone-Lee”). Comme on se refile entre connaisseurs un coin à morilles, les fans français s’étaient passé sous le manteau les informations concernant un concert nantais le 30 décembre 1975*, événement qui inspira la Une de Jazz Magazine en février avec reportage et interview en coulisse de Chris Flicker, et celle de Jazz Hot en mars avec un beau dossier de 24 pages (hors interview de Warne Marsh) par Jean Delmas sur l’héritage de Lennie Tristano, débordant sur le numéro suivant
Et c’est donc au moins tout autant pour Lee Konitz et Solal que pour le Trio Surman-Phillips-Martin que j’étais présent ce 16 mars au studio 104. J’allais dire que cette deuxième partie n’ayant pas fait l’objet d’une publication, je n’en ai gardé qu’un souvenir vague. L’impression d’être admis dans le Saint des Saints – ce qu’étant profondément athée j’aurais tendance à orthographier le Sein de seins, me référant à quelque mythologie matriarcale imaginaire – parmi une foule de connaisseurs “à qui serait le premier à souffler à l’oreille de son voisin le titre du standard qui venait à peine d’être introduit”, “à qui manifesterait le mieux son émotion à l’annonce de tel ou tel titre”, “à qui s’esclafferait le plus fort aux mots d’esprit de Lee Konitz”. Je restai coi, me laissant saisir par ce double sentiment constant de déjà entendu et d’inattendu, de familiarité et d’égarement. J’allais dire qu’en dépit de cette imprécision de la mémoire, j’en avais conçu comme un baptême d’initiation au monde des standards dont je commençais à prendre conscience et à cette culture commune, mortier de la complicité Konitz-Solal dont l’avenir témoignerait à chaque nouveau concert du caractère irréductible entre ces deux personnages tellement différents et complémentaires. J’allais dire… et puis je tombe un peu par hasard sur une copie CD de trois des morceaux de ce concert, probablement d’après un lot de bandes magnétiques aujourd’hui perdues où je stockais des heures de retransmissions d’André Francis captées sur les ondes.

J’y retrouve What’s New dont Lee Konitz nous indique la première phrase par bribes, comme pour nous mettre sur la voie avant de nous laisser nous débrouiller, car tout de suite après il joue la variation, et il y a du Bach dans sa façon de dérouler la phrase, sans rien prévoir, comme se laissant dicter chaque note par sa précédente dans une espèce de rêve éveillé ou Solal vient le rejoindre… J’avais écrit à l’occasion d’un concert en duo des années 1980, “le lièvre et la tortue”. Ici c’est le lièvre et le papillon : dès que le lièvre Solal surgit, filant à travers champs, il laisse le papillon Konitz sur place en suspension au-dessus d’un petit groupe de notes, puis qui se met à voleter d’un bouquet à l’autre. Et si Solal daigne l’y rejoindre, c’est avec la vivacité de l’abeille qu’il besogne sa récolte. La rythmique entre, pour laquelle le critique de Jazz Magazine, Daniel Soutif, se montra sévère. Certes, le son de la contrebasse ne sonne pas très joliment – on sonorisait fort mal les contrebasses à l’époque –, mais elle est joliment active au milieu de cet incessant chassé-croisé du piano et de l’alto, et Al Levitt est loin de jouer les utilités, même s’il joue du bout de ses balais, somme toute très audacieux.
Du thème d ‘Anthopology, Peter Ind joue les phrase A à l’unisson de l’alto, avec un Al Levitt tout à son affaire dans l’héritage de Roy Haynes. Et ça barde. Après un solo de Solal d’une audace et d’une bravoure inouïes, Konitz montre que, s’il sait rêver, il sait mordre et foncer. Enfin, il y a un morceau dont je n’ai pas su noter le titre sur sur le boîtier de mon enregistrement… Et bon sang, mais c’est bien sûr ! Quarante-quatre ans plus tard, ça me semble évident. Cet unisson sax-contrebasse, c’est le solo de 1936 que Lady Be Good inspira à Lester Young au sein du noyau dur d’un Count Basie Orchestra qui n’avait pas encore gravé son nom dans la cire. Et me revient soudain que la première fois que j’ai entendu nommer ce titre, c’était ce 16 mars 1976. Ne comprenant pas l’anglais – ça fait partie des aberrations de mon parcours professionnels –, je me rappelle tout à coup qu’entre deux morceaux, Konitz avait prononcé les mots de « Lester Young » et de « Lady Be Good » assortis d’un geste de la main semblant signifier « et cetera ». J’avais alors rapidement balayé du regard l’assistance en tous sens pour voir si, parmi les quelques connaisseurs qui, à cette annonce, avaient manifesté leur contentement, je ne pourrais pas identifier Alain Gerber dont j’imaginais qu’il pouvait être l’un d’eux mais qui n’était encore pour moi qu’une signature et une voix sur lesquelles j’avais hâte de fixer un visage. Et, ignorant encore quasiment tout de ce Lester et de cette Lady, je m’étais dit qu’il y avait là une information importante à retenir et à creuser. Comme quoi le confinement de ce 16 mars 2020 aura eu du bon. Franck Bergerot
* Avec les mêmes Al Levitt et Peter Ind, plus le guitariste Dave Cliff et, sur deux morceaux, Martial Solal. Jazz Magazine donnait le 12 décembre, Jean Delmas dans son compte rendu et Jack Goodwin dans sa discographie de Warne Marsh donnent le 30, ce dernier signalant la présence des micros de Radio France, au moins pour 9 des 15 titres répertoriés, cinq ayant été diffusés à l’antenne. D’ailleurs, le 12 décembre, Warne Marsh et Lee Konitz étaient à Dordrecht, en Hollande.