Appelons-la Cecile

Programmée samedi dernier sur France Musique, dans le cadre de l’émission Jazz sur le Vif d’Arnaud Merlin, Cécile Mc Lorin Salvant a fait sensation. A trente ans, la voilà déjà dans la cour des très très grandes.
Cécile Mc Lorin Salvant (voix), Sullivan Fortner (piano), Studio 104 de la Maison de la Radio, Jazz sur le Vif, 18 janvier 2020

Par quoi commencer ? Par les quatre rappels, dont l’ultime, Ma plus grande histoire d’amour, fit chavirer les spectateurs du studio 104 ? Ou par l’éclectisme renversant et maîtrisé du répertoire, qui rassemble en une même farandole joyeuse, Barbara, Cole Porter, Damia, Gregory Porter et John Lennon ?
Ce qui est sûr en tous cas, c’est que Cécile Mc Lorin Salvant, 30 ans, chanteuse franco-américaine ayant grandi à Miami puis à Aix en Provence, lauréate du prestigieux concours de jazz Thelonious Monk en 2010, est en train de dépasser toutes les attentes, de confirmer toutes les espérances.
Qu’a-t-elle de spécial cette jeune chanteuse ? D’abord une voix exceptionnelle dont elle fait ce qu’elle veut, capable de lui donner une ampleur océanique, ou d’en faire un stylet qui vient piquer l’auditeur au creux de l’estomac. Mais cette voix est tenue en laisse. Elle n’en utilise la puissance que comme un moyen d’expression, jamais comme un moyen de démonstration. L’expression, l’expressivité, voilà le cœur de sa démarche musicale. Grâce à sa voix mais aussi à sa diction, qualité trop sous-estimée chez les vocalistes. Avec Cécile Mc Lorin, que ce soit en Anglais ou en Français, on comprend tout. Chaque mot apparaît dans sa plus exacte lumière. Les chansons les plus connues se parent de mille nuances inédites. Par exemple J’ai l’cafard, de Damia, qu’elle emmène bien loin du folklore néoréaliste, pour en faire une Torch song à la française, dont il nous semble alors, grâce à elle, entendre les paroles pour la première fois : Je hais ce plaisir qui m’use/ Et quand on croit que j’m’amuse/ J’ai des pleurs/ Plein mon cœur.

Ce talent de diseuse est éclatant lorsqu’elle utilise le parler-chanté (par exemple dans les deux chansons de l’Opéra de Quat’sous qu’elle a interprétées samedi soir). Elle fait exister si puissamment les chansons, se les approprie avec tant de force qu’elle semble destinée un jour ou l’autre à être actrice autant que chanteuse, dans une de ces comédies musicales dont elle truffe son répertoire. C’est ce que je me suis mis à penser à peu près au milieu du concert. Et je me disais : Mais quel auteur génial saura écrire un rôle à la mesure de ce talent hors normes ? La réponse est venue une ou deux chansons plus loin. C’est elle ! C’est elle, bien sûr, qui va s’écrire son propre opéra. D’ailleurs, elle en a déjà écrit un. Cela s’appelle L’ogresse amoureuse, et elle en chanté un extrait samedi soir. Et bien sûr, c’est superbe.
On suspecte, dans cette ogresse, une dimension d’autoportrait consciente et assumée, tant Cecile Mc Lorin pioche avec gourmandise dans tous les registres, dans tous les genres. Son péché mignon, ce sont les vieilles comédies musicales méconnues, comme You can’t get a man with a gun (1946) histoire d’une tireuse d’élite amoureuse (ça se passe au far-west…) d’un autre tireur d’élite. La chanson est piquante, décalée, et comporte trois vers insurpassables : A man may be hot/ But he’s not/ When he’s shot…
Mais Cecile Mc Lorin n’est pas seule sur scène. L’ogresse est accompagnée par un ogre. Il s’appelle Sullivan Fortner, et c’est son pianiste. C’est l’exact contraire du pianiste en livrée, chargé de déployer le tapis rouge sous les escarpins de sa chanteuse. Lui semble incroyablement libre, presque dans sa bulle, même si de rapides coups d’œil indiquent qu’il sait toujours, comme un cavalier avec sa cavalière, où il se situe par rapport à elle.

Sullivan Fortner semble vouloir épuiser la musique tant ce qu’il joue est dense. En deux minutes, il fait naître plus de fusées et d’étoiles filantes qu’un pianiste doué ne pourra concevoir en vingt minutes. A certains moments il joue, magnifiquement, dans un style swing traditionnel, enchaîne les block chords, puis s’échauffe, arrive à ébullition, et bascule de l’autre côté du miroir, avec des figures abstraites, biscornues, aux confins de la musique contemporaine. Cecile Mc Lorin accoudée au piano, observe cette traversée du miroir, amusée, fascinée…
Le reste du temps, elle se balade sur scène, souriante, chaleureuse, n’oubliant jamais de s’adresser à tous les côtés de la scène. Elle reste spontanée et ne joue pas la diva. Elle s’asseoit à côté du pianiste et le fait chanter. Il a une voix qui rappelle Stevie Wonder. La complicité entre les deux est patente. Chaque morceau est l’objet d’un petit soliloque. « You decide » lui dit elle plusieurs fois. Parfois Il joue alors un accord, deux accords et elle fait « Oh », comme si on venait de lui parler d’un vieil ami.
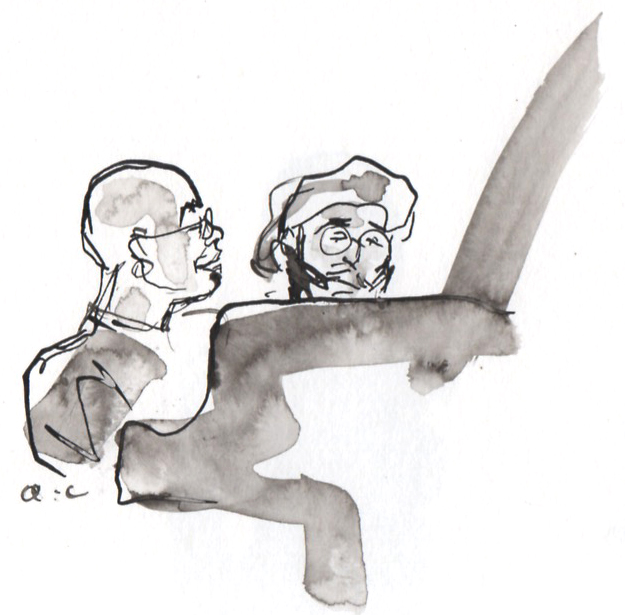
Et l’on arrive à la fin du concert. On a déjà entendu des merveilles, comme cette chanson de Gregory Porter, No love Dying. Le plus beau reste pourtant à venir, avec deux derniers rappels chantés sur le fil de l’émotion, All my love, de John Lennon, et Ma plus belle histoire d’amour c’est vous. Deux chansons qui sont des mises à nu. Cecile Mc Lorin emmène la chanson de Barbara très haut. En restant dans l’émotion sans jamais glisser dans le pathos, elle fait sentir toutes les nuances de cette chanson épique qui parle d’amour du public, mais aussi de rage, de colère, de réconciliation. C’est intense et vertigineux.

En introduction de ce concert, Arnaud Merlin (France Musique) avait présenté la chanteuse en la situant dans la lignée de ses prestigieuses devancières : « Il y avait Billie, Ella, Sarah, il y a maintenant Cecile ». Gageons qu’aucun spectateur présent ce soir là n’aura trouvé la comparaison exagérée. Appelons-là Cecile…
Texte : JF Mondot
Dessins : AC Alvoet (autres dessins , peintures gravures visibles su son site annie_claire@hotmail.com)